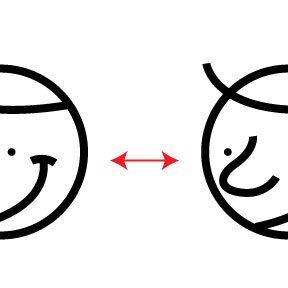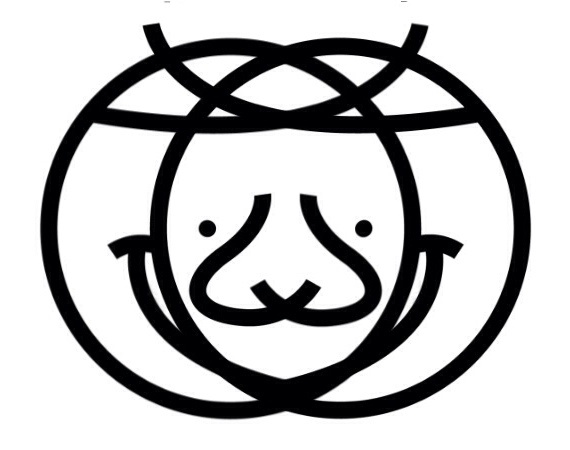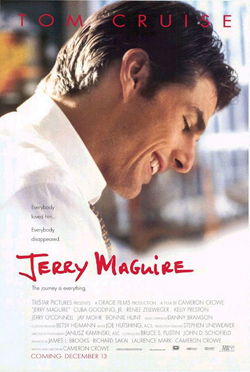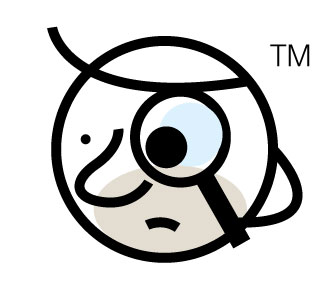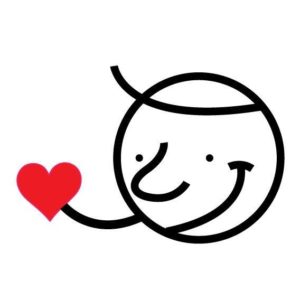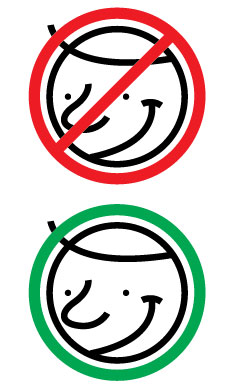Poqué run.
 Je suis né à Chicoutimi, sur la rue Petit. Dans un quartier ouvrier de l’époque. Aujourd’hui, on dirait défavorisé. Mes parents n’étaient pas riches, mais on vivait bien. Mieux que plusieurs de nos voisins. Je fréquentais la défunte école St-Philippe, aujourd’hui devenue une coopérative de logements sociaux. Une école bâtie derrière une voie ferrée. Par où nous traversions de manière à gagner du temps quand la cloche sonnait. C’était dans les années 70.
Je suis né à Chicoutimi, sur la rue Petit. Dans un quartier ouvrier de l’époque. Aujourd’hui, on dirait défavorisé. Mes parents n’étaient pas riches, mais on vivait bien. Mieux que plusieurs de nos voisins. Je fréquentais la défunte école St-Philippe, aujourd’hui devenue une coopérative de logements sociaux. Une école bâtie derrière une voie ferrée. Par où nous traversions de manière à gagner du temps quand la cloche sonnait. C’était dans les années 70.
Comme j’habitais le centre-ville, la faune qui gravitait autour de chez nous n’était pas toujours jojo. Les mauvaises fréquentations étaient faciles. J’ai eu la chance d’avoir des parents qui tenaient le fort. Capables de me ramener à l’ordre quand c’était le temps. C’était pas toujours le cas pour mes amis ou voisins de quartier. C’est là que tu réalises que la ligne est mince entre choisir un chemin droit et un autre qui fait prendre à ton destin, une direction plus difficile.
Plus j’ai avancé dans la vie, plus j’ai eu à faire des choix. J’en ai fait des bons. Des moins bons. Je ne suis jamais tombé dans l’excès. Ou si peu.
Sans avoir un caractère fort, j’ai toujours eu cette indépendance qui m’a permis de ne pas suivre aveuglément les personnes que j’ai croisées dans ma vie. Leurs mauvaises décisions sont rarement devenues les miennes. Les mauvaises, je les prenais par moi-même. Je n’ai pas de mérite plus qu’il faut. J’ai eu la chance d’avoir des parents présents, d’avoir des passions comme le dessin, l’écriture, la lecture et plus tard, le sport. Tout ça m’a permis de m’accrocher dans les moments les plus durs.
Certains n’ont pas cette chance.
Quand tu regardes plus loin que ton nez, tu réalises que beaucoup d’enfants sont déjà des éclopés de la vie, même si celle-ci commence à peine.
Né dans un milieu défavorisé. Parents absents. Avec personne pour les écouter, pour en prendre soin. Problème de consommation d’alcool ou de drogues. Problème de violence. Problème mental.
Né poqué.
Né tout croche avant même que ta vie commence.
C’est fou comment on peut passer à travers la vie sans se rendre compte de tout ça.
En fait, ce n’est pas tout à fait vrai. On lit les grands titres dans les médias. Quand un jeune fait une fugue ou commet un acte répréhensible, on juge le geste. En oubliant la plupart du temps que c’est une conséquence plutôt qu’une résultante. À un manque d’éducation / d’amour / d’argent. On oublie. Ou on préfère se fermer les yeux. C’est plus facile.
Le 13 mai prochain, je vais courir avec quelques jeunes qui ont déjà eu leur part de problèmes malgré leur jeune âge. Certains qui veulent s’en sortir, d’autres qui ne savent pas comment. D’autres qui ne voient pas la lumière.
J’ai accepté l’invitation de mon ami, Éric Larouche, de devenir ambassadeur de la Course de la Fondation de l’enfance et la jeunesse. On va rencontrer ces jeunes, leur parler, s’entraîner avec eux, financer leurs équipements et faire la course.
J’ai accepté même si je suis blessé, que je suis en convalescence et en retour progressif à la course. Parce que ma blessure est seulement physique. Et que celle de ces kids est plus profonde. Une âme amochée, ce n’est pas un tendon récalcitrant.
On va courir avec cœur. Ça devrait aller.
P.S vous avez du cash et/ou vous êtes coureur? Pourquoi ne pas venir avec moi?
Billets que vous pourriez aimer
Sous les couvertures
 Je suis né sous les couvertures.
Je suis né sous les couvertures.
Enveloppé dans le papier.
Comme un chocolat fin.
Les livres font partie de ma vie comme l’air que vous respirez.
Je m’en entoure.
J’en consomme.
Je suis un junkie littéraire.
J’ai acheté des livres.
Emprunté des livres.
Volé des livres.
J’ai déménagé des livres toute ma vie.
Ou toutes mes vies.
Criss.
C’est quoi cette boîte impossible à lever.
Des livres.
Criss.
Livres salon.
Livres cuisine.
Livres BD.
Livres bureau.
Livre maman.
– Marc, tu pourrais ramener tes livres chez vous?
Oui. Je sais. Mais, non.
Devant la bibliothèque de ma chambre (encore présente) dans la maison de ma mère, mon doigt descend l’épine des livres. Bob Morane. Les Coq d’or. Tout connaître. Je me renseigne sur. Métal Hurlant. Fluide Glacial. Thor. Spiderman. Hugo, Sartre, Druillet, Gotlib, Voltaire, Thériault. Savard.
Des livres laissés là.
Comme ceux qui se retrouvent dans mon bureau au bureau.
Ou ceux du bureau à la maison.
Y a aussi ceux du salon.
Lus. Pas lus.
Pourquoi lui il est là et pas moi. Pourraient-ils me dire en chœur.
Je n’en sais rien.
Je sais pourquoi vous vous retrouvez avec moi.
Mais je ne sais pas l’ordre dans lequel vous serez lu.
Si vous le serez.
Oh.
Ben oui.
T’arrives dans ma vie. Tu peux te retrouver sur une tablette, pour l’éternité. Ou être dévoré en 12 heures. Tu peux traversé 3 continents. Plié en deux dans un sac à dos. Ondulé sous l’humidité d’une plage. Mourru dans la poussière sous mon lit, un signet au milieu du corps. Relu deux ou trois fois. Tu peux être passé à quelqu’un sans jamais revenir. Je vous aime, mais je ne suis pas nécessairement attaché. Comme les lettres.
Pas assez de temps.
Trop de livres à lire.
À vivre.
Je suis né sous les couvertures.
Nourri par ma passion.
Et celle les autres.
Tante Monique qui m’initie à Reiser et San Antonio à un âge où il ne faut pas lire San Antonio. Encore moins Reiser. Ces profs avec leurs lectures obligés. Les amis qui nous disent qu’il faut lire ça. Les libraires qui m’ont pushé dans les narines, des romans et des bédés. Les revues littéraires. Les quotidiens. Le web. Le criss de web. Qui te fait découvrir la littérature du Monde.
Des livres venus d’ici et là.
Achetés neufs.
Usagés.
En ligne.
Sur place.
En français.
En anglais.
En espagnol. Abandonné après 3 chapitres. Incompréhensible.
Y’a toute sorte de dépendances.
C’est la mienne.
J’ai plus de livres que j’en ai lus.
Comme disait mon amie Monique Lo: on les lira à la retraite quand on aura plus d’argent pour en acheter. En attendant, consommons ces mots imprimés sur le papier comme si c’était un parfum qui nous donnerait la vie éternelle. Fontaine de Jouvence. Fontaine de Jouissance. Surtout.
Les livres sont toute ma vie.
Je lis tout ça.
J’écris tout ça.
Sans écrire le mien.
Mon livre.
Un jour.
Oui. Oui.
Un jour.
À suivre.
Billets que vous pourriez aimer
Le beau monde.
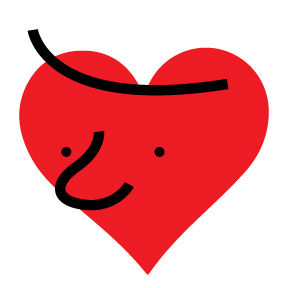 Une chaussée glacée.
Une chaussée glacée.
Une auto qui dérape.
En tentant de l’éviter, elle dérape à son tour.
360 degrés. X 10.
Ice Capade.
Et bang.
Un impact.
La voiture à l’horizontale.
Toujours attachée dans celle-ci, écrasée au fond de son siège, elle tente de bouger malgré le mal de dos causé par l’impact.
Une voix l’interpelle.
– Tu es OK?
Vous pensez que ce sont les grands mouvements qui sauveront le monde? Les grandes remises en question. Les grands rassemblements. Les grandes causes.
Vous avez tout faux.
Ce sont des phrases comme « Tu es OK? »
Ce sont de simples gestes.
L’humanité.
L’aide.
L’autre.
Ce sont les individus, eux-mêmes, qui feront la différence.
C’est ma fille qui était dans l’auto qui a dérapé.
Quelque part entre l’Étape et Québec. Dans le Parc.
Lundi dernier.
Ma fille a fait un tête-à-queue et s’est retrouvée prisonnière de sa voiture, au beau milieu de la route. Au milieu de nulle part. Dans le froid. Toute seule.
Et puis une personne s’est arrêtée.
Et puis une autre.
À leur deux, ils ont réussi à la secourir.
À vérifier si elle était OK.
Ils ont réussi à la sortir de la voiture.
La réchauffer.
Appeler la police. L’ambulance.
M’appeler moi.
Tout en la rassurant.
La consolant.
Tout en me rassurant.
Deux étrangers.
Arrêtés malgré le froid et le danger.
Un gars et une fille qui ne se connaissaient pas qui, l’espace d’un instant, se sont improvisés duo de sauveteurs.
– Merci pour ce que vous avez fait.
– Pas de problème, monsieur et rappelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit.
J’ai raccroché.
En réalisant ne jamais avoir demandé le nom de mes bons samaritains.
Quand je suis arrivé à l’Hôpital Saint-François d’Assise à Québec, rejoindre ma fille, elle m’a tout raconté. Comment ces gens se sont occupés d’elle. L’ont rassurés. En attendant les secours.
On peut parler de fraternité.
D’égalité. De tolérance.
On peut tenir de grands discours.
Dire que l’autre est important.
Dire qu’on est ouvert.
Mais quand vient le temps de le prouver, qui se lève vraiment?
Qui met vraiment ses principes en action?
Qui passe de la parole aux actes?
À mon retour de Québec, ma fille m’a texté.
Par Facebook, la fille qui l’avait aidé a communiqué avec elle.
Pour lui demander si tout allait bien.
Pour lui dire qu’elle avait pensé à elle toute la journée.
Ça m’a ému.
Les gens sont capables d’humanité dans les gestes les plus simples.
Quand les plus pessimistes diront que le monde est rendu fou.
Que le monde est à pleurer.
Que le monde est laid.
Que la planète est en guerre.
Il y aura toujours des personnes qui les feront mentir.
Qui feront la différence.
Qui placeront l’Autre en priorité.
Qui diront que le monde est beau.
Comme ces deux personnes dont je ne connais pas le nom.
Mais dont je connais maintenant la grandeur d’âme.
Merci.
Billets que vous pourriez aimer
L’âge dort.
Dans les quelques 500 billets parus, y en a au moins 8 qui parlent de ma fête.
Un à chaque année.
Qui parle de vieillir.
Négativement.
C’est poche de vieillir. C’est plate. C’est diminuant. Eurk.
Au-delà de 5000 mots vous vomissent la hargne que j’ai à déchirer la dernière page du calendrier.
Parce qu’en plus, je suis né en décembre. Ça fait que j’ai l’impression de vivre mon année à crédit et de vieillir à la fin de celle-ci.
Tiens, ton année est finie. Paie. Change de chiffre, bonhomme.
À mon dernier anniversaire, je n’ai rien écrit.
Niet.
Rien sur mon âge. Rien sur ma fête. Pas de mots poubelles.
J’ai fait parvenir des fleurs à ma mère pour la remercier de m’avoir mis au monde pour voir le Monde.
Bon, c’était facile puisque j’étais en Indonésie, vous me direz. Mais j’étais ailleurs les dernières années aussi.
J’étais peut-être à l’extérieur, mais j’ai eu l’impression d’être beaucoup plus à l’intérieur.
De moi.
Ce dernier voyage m’a fait constater un paquet de trucs que j’avais décidé d’ignorer. Pour toutes sortes de mauvaises raisons.
J’ai une bonne santé. Mon corps tient le coup. Un peu excessif, oui. Capable de me renverser d’aplomb. Alcoolo social. Je dors peu. Je mange bien. Même si souvent, trop. Je fais de l’exercice. Même blessé. Il y quelques méandres qui apparaissent sur mon visage. Des taches sur les mains. Des poches sous les yeux. La barbe de deux jours est blanche. Le muffin qui me sort des jeans. Mais la plupart des trentenaires que j’ai croisés, pendant mon voyage, me donnaient une dizaine d’années de moins. Take it man. TAKE IT. Je fuis moins les miroirs depuis mon retour.
Ma tête ne va pas si mal non plus. Elle est fragile. Capable de plonger dans le noir. Mais la lumière n’est jamais loin. Je suis en apnée. Je plonge, mais jamais trop loin pour ne pas en revenir. J’ai des idées noires. Mais tout autant des idées multicolores. J’imagine que tout ça s’annule. Équilibre? Peut-être. Je m’en balance. J’ai déjà vu neiger. Mes opinions sont plus grises qu’avant. Les grands débats me laissent de marbre. Je fuis les raccourcis. Je réfléchis.
Je suis privilégié. Bon, en fait nous le sommes pas mal tous ici quand on se compare au reste du monde, mais disons qu’ici, je fais partie des privilégiés. Je n’ai pas l’impression que c’est de la chance : je travaille au même rythme qu’à mes 20 ans. Soirs. Fins de semaine. Je travaille peut-être trop. Mais ma tête et mon corps le prennent bien. Et j’ai la «chance» d’aimer ça. Sinon je quitterais tout. Je suis conscient que tout ça repose sur moi. Que si je tombe malade, tout s’écroule. Que la retraite dépend uniquement des choix que je fais. Aucune organisation qui prendra soin de celle-ci. Je ne me plains pas : c’est la vie que j’ai choisi.
J’ai l’impression d’avoir atteint un point de bascule. D’avoir arrêté le temps. Que l’âge dort en moi.
Pour combien de temps?
Bof.
Qui sait.
Je suis capable de 180 degrés.
Je ne suis pas à un premier deni.
Capable de virer boutte pour boutte.
Je prends ce moment de répit.
Je me permets d’arrêter le temps.
C’est encore la meilleure façon de vieillir.
Lentement.
Billets que vous pourriez aimer
Chroniques indonésiennes #1
 Ubud
UbudOn devait rouler depuis plus d’une heure.
Le vent qui fouettait mon visage.
Le soleil sur mes genoux.
Le décor vert. À perte de vue.
Mon sarong rose qui flottait comme un drapeau sur mes cuisses.
Rose is good for you. Oui, oui. J’imagine.
L’odeur des rizières. Celle de l’essence. Et celle de l’Indonésie.
Inconnue à mes narines y’a moins de trois jours.
Et c’est à ce moment précis, comme un déclic, que j’ai croisé dans le rétroviseur du motobike de Ada, mon gros sourire. Celui de l’ivresse. Celui qui ne pense à rien. Bêta.
Je suis arrivé. Je suis là. Ou plutôt ici.
Je suis ici depuis dimanche, mais j’arrive à peine.
Je me suis promené dans Ubud, mais j’étais un automate.
Désarticulé.
Mange Pis Dors.
Et puis il y a eu la route, les paysages qui se fondent, cette végétation luxuriante gorgée d’eau que cette saison des pluies nous apporte sans crier gare. Cette pluie qui nous a surprise, au retour. Rouler dans l’averse. Rouler dans l’eau. À transpercer nos impers jusque dans nos os. Cette pluie qui rend les touristes plus frileux à visiter le pays dans cette période.
Tant mieux.
Parce que moi, j’y suis.
 Ubud (2)
Ubud (2)
Hier, j’ai peut-être un peu exagéré ma scène d’orage. Je pensais avoir été mouillé. En fait, j’aurais dû parler d’une légère bruine. Une ondée.
Aujourd’hui, mais AUJOURD’HUI, c’était le déluge, LE DÉLUGE !!!
Le commandant Ada Cousteau et son assistant, le pas très futé Gilligan Gauthier, ont flotté pendant deux longues heures sur des routes sinueuses à bord du vénérable motobike rose. Version balinaise du Yellow Submarine.
Est-ce que l’eau venait d’en haut ou dans bas? Difficile à dire.
Je n’y voyais rien.
Nada.
J’ai ouvert les yeux, pour y voir encore moins. Alors, je les ai refermés.
En le voyant dépasser tout ce qui bougeait sur notre passage, j’ai pensé demander à Ada si, lui, il voyait la route, mais je me suis dit que je devais éviter de l’embêter avec mes questions impertinentes. Après tout, c’était lui le chauffeur. Gilligan devrait connaître son rang.
Au bouiboui, où l’on a décidé d’arrêter histoire de voir si la pluie ferait pareil, j’ai croisé deux touristes françaises. Je leur ai dit que chez nous, on dirait qu’il mouille en tabarnac. L’une d’elles m’a répondu que chez eux, on dirait : il pleut comme une vache qui pisse. Well. J’imagine. Un peu.
On en a profité pour manger des trucs pas bons épicés. C’est parfait comme ça. Si ce n’est pas bon, faut que ça soit épicé. Sinon ça goûte le pas bon. Avec un bock de thé tiède sucré.
J’ai roulé le reste du chemin, la bouche ouverte.
Bref, depuis le début de mon voyage, je m’hydrate assez bien.
Tellement qu’aujourd’hui, j’ai même eu droit à un lavement.
 Ubud (3)
Ubud (3)
Hier, j’ai arpenté une dernière fois les rizières d’Ubud. Vous dire le plaisir de m’y retrouver serait un euphémisme. L’odeur des champs. Le son des canaux qui distribuent l’eau. Les paysans qui y travaillent. Si fort. Comme en Colombie, cet été, quand j’ai réalisé que chaque grain de café qu’on boit avait été cueilli à la main, il en est de même pour le riz. Une job tought. Les paysans. Pour la plupart des femmes. Accroupis. Les genoux dans l’eau. Bouffés par les moustiques. Pour le touriste que je suis, la vision bucolique des champs verts bouscule la réalité que ces gens doivent vivre quotidiennement. De la même manière qu’on jouit du prix d’un t-shirt acheté récemment qui dépend du labeur de travailleurs sous-payés dans une usine du Bangladesh. Je ne fais pas de moral : je suis, moi-même, un hyper consommateur. Je parle plutôt de l’image que certaines situations, vécues ici comme ailleurs, projettent par rapport à leurs réalités. Un clash. Une fissure. On trouve ça beau, mais pour d’autres, ça l’est pas mal moins.
Je quitte Ubud, ce matin pour le nord de l’île de Bali. Amed. Un tout petit village de pêcheurs. J’ai beaucoup aimé Ubud. J’en avais pourtant une grande crainte : le mange-prie-aime, les bobos, les granos; ils tous là, mais la ville est plus que ça. Quand Ada m’a demandé ce que j’avais le plus aimé depuis mon arrivée, quel temple, lieu, etc. Je lui ai répondu : les gens.
Je sais. Je suis un cruiseur.
 Munduk
Munduk
Je venais à peine de m’assoir et commander une bière quand le smog s’est abattu sur Munduk. Un épais nuage opaque a tout fait disparaître sur son passage. Mon univers s’arrêtait à peine de l’autre côté de la rue. Signe annonciateur d’un orage à venir.
La bière est arrivée. La pluie aussi.
Content d’être à l’abri.
Ici, les orages sont sévères. Et sournois.
Aujourd’hui, j’ai tout de même été chanceux. J’ai été épargné par l’eau. J’arrivais tout juste d’une randonnée de quatre heures, dans les chemins sinueux du village. À monter. Descendre. Parmi les champs et les rizières. À répondre allo quand on me disait allo. À des enfants et des petits vieux. Les autres étaient occupés à travailler.
Dans un de ses sentiers, je suis tombé sur un chien avec une gueule à avoir le goût de manger du gras. J’ai continué à avancer, tentant si bien que mal de l’ignorer. Ses aboiements n’ont pris qu’un instant pour alerter deux autres clébards, sortis de nulle part. Alors que j’avais le trio cabot dans les pattes, voilà que deux autres se sont joints à la danse. Tous à aboyer à qui mieux mieux. Ça commençait à être beaucoup moins drôle. Surtout que le meneur n’était pas mal en salive et agressif. Je suis arrivé près d’une maison et un paysan m’aperçut avec mon quintette aux talons. Il me tendit un bout de bois en me mimant de frapper les chiens. J’ai fait signe que non. Il a insisté. J’ai pris la perche et fouetté le premier chien, le plus fort en gueule. Il a figé et est parti à courir, apportant avec lui, dans son sillon ses quatre compagnons dans un silence le plus complet. Le paysan a ri. Moi, j’étais plutôt surpris. Je lui ai redonné son bâton et continué ma route. Comme dans la vraie vie, tu attaques le bully, pis les petits suiveux déguerpissent.
Mais, je m’éloigne. Je parlais de la pluie.
De la terrasse couverte, d’où je sirotais ma bière, j’observais les gens sous la pluie.
Ces deux jeunes filles avec leur mère, brouette et pelles en main, à faire des voyages de sable trempé qu’elles apportaient aux maçons, en bas de la côte. Cette femme avec son panier sur sa tête et sa bêche à la main qui s’en allait bosser je ne sais où. Ce couple sur un motorbike, arrêté un moment, le temps de se couvrir machinalement d’un imper pour deux. Ce cultivateur, la serpe à la main, retournant aux champs.
J’étais le seul couvert. Et pourtant, j’étais le seul qui semblait sentir la pluie. Comme si la pluie ne les atteignait pas. Qu’ils étaient imperméables.
C’est étrange, cette relation qu’on peut avoir avec le climat. Alors que certains semblent le subir, d’autres l’apprivoisent. À s’en ficher. À ne plus le sentir.
J’ai commandé un thé au gingembre. Le temps que la pluie cesse.
Mais elle n’a jamais cessé.
J’ai payé ma facture. J’ai sorti l’imper de mon sac. Et je suis parti dans les torrents.
Les deux jeunes filles à la brouette m’ont dit allo. J’ai dit allo.
Pas à l’eau.
Moi aussi, je m’en viens pas pire avec la pluie.
 Amed
Amed
Dogs And Gods.
Les chiens de Bali.
Ils sont partout sur l’île des Dieux.
On en croise dans les rues.
Au détour d’un arbre, dans un trek, en pleine jungle.
Dans les temples.
J’en ai même vu un pisser dans un resto.
Bali est envahie par les chiens.
Errants. Répugnants. Malins. Parfois coquins, mais rarement.
Avec larme à l’œil.
Avec l’arme à l’œil.
Sur la route, certains nous grondent dessus.
En motorbike, d’autres veulent nous mordre les talons.
Dans les chemins, ils sortent les crocs.
Moi, qui aime les chiens, j’ose à peine imaginer quelqu’un pour qui c’est la phobie.
Un contraste avec ses habitants souriants.
Comme si au partage des sentiments, on aurait attribué celui de la haine, aux chiens.
Avec tous ces cabots errants, Bali a un problème connu de rage. Ce que le pays a tenté d’éradiquer par des exécutions massives, dénoncées par les associations de défenses des animaux d’un peu partout dans le monde.
Ce qui est surprenant, c’est qu’avec autant de chiens, c’est l’absence… de crottes. Chez nous, chiens en laisse et petits sacs en main, on croise quand même un tas à chaque coin de rue. Pas ici. T’as pas mal plus de chances de mettre le pied dans un petit panier d’offrandes aux Dieux, déposées sur le trottoir, en face de chaque maison / commerce, chaque jour.
J’imagine que les Dieux s’en chargent.
 Bromo
Bromo
Je devais avoir moins de 10 ans quand j’ai gagné un concours de dessin organisé par le Journal de Québec. Comme prix, une bande dessinée au titre bizarre : Le Cosmoschtroumpf. Je ne connaissais pas encore ces drôles de personnages tout bleus. Dans le livre, un des schtroumpfs rêvait de devenir astronaute; le Grand Schtroumpf, pour le contenter, monta une grande mascarade dans laquelle il faisait croire à l’apprenti pilote qu’il avait atterri sur la lune alors qu’il l’avait simplement amené, grâce à un subtil subterfuge à l’intérieur d’un volcan éteint.
Dans les quatre derniers jours, j’étais le Cosmoschtroumpf.
J’ai aussi visité la lune.
Deux fois plutôt qu’une.
Le Kawah Ijen et le Bromo.
Des paysages abrupts. Une odeur âcre de soufre. Des montées difficiles, voire dangereuses pour le Kawah Ijen en tout cas. Impressionnant. Vraiment. Ça valait les levés du corps à 1h du matin, pour voir les levers du soleil, ça valait aussi les kilomètres de montées pas toujours faciles. Ça valait les kilomètres de route et les gîtes pour dormir plus ou moins intéressants. Comme une image vaut mille mots, en voici 6000.
 Yogyakarta
Yogyakarta
Je n’allais pas chroniquer sans vous parler des gens.
Parce que c’est là l’essence même du voyage.
Oubliez les volcans, les temples et les rizières.
C’est beau tout ça, même magnifique, mais Google vous le montre beaucoup mieux que moi. Et vous dire comment c’est encore plus beau en vrai.
Tu voyages seul?
Ça doit être plate / difficile / dangereux / mettez le mot qui vous fait le plus peur. Parce que dans le fond, ce sont vos propres appréhensions que vous me projetiez.
Je ne voyage pas seul.
Y a plein de monde autour de moi.
Des gens qui habitent les quartiers où je débarque.
Les autres voyageurs de partout dans le monde.
Où que vous soyez en Asie, c’est fou le nombre de passeports différents que j’ai eu à croiser. Des Polonais, des Russes, des Italiens, des Indiens, des Français, des Autrichiens, des Hollandais et j’en passe. Faites tourner un globe et placez votre doigt au hasard, je vous jure que je l’ai croisé. Ou son voisin.
Voyager seul, c’est aussi voyager avec soi-même.
Oui, oui ça fait mystique. Mais c’est fort vrai.
Vous êtes-vous déjà entendu respirer?
Vous êtes-vous déjà demandé : au fond kossé que je veux?
Quand tu voyages seul. C’est ça.
Tu t’entends penser.
Tu te parles. Et tu te réponds.
Tu fais un voyage, dans le voyage.
Un voyage intérieur.
Et je peux vous dire, par expérience, que partout y a des contrées pas mal moins hostiles que soi-même.
Voyager seul, tu vois le monde par tes yeux.
Avec tes préjugés. Tes peurs. Mais tout autant, ton sourire et ton bonheur. Dans le fond, le monde te donne ce que tu lui donnes. Simplement.
Les gens de Yogyakarta qui ont si aimablement accepté d’immortaliser leurs visages sur ma lentille, l’ont fait par goût, défi, plaisir ou simplement parce qu’ils venaient de me demander la même chose. Immortaliser mon passage chez eux.
J’ai eu un coup de cœur total pour la petite dame qui tient un mini dépanneur à l’entrée de la ruelle où j’ai passé dix fois par jour. Matin, midi, soir. Hier, en fin de journée, je lui ai demandé de poser pour moi. Elle s’est assise, a placé ses cheveux et remonté son menton. Fière. J’ai tout de suite vu ses mains. Des mains pleines de vie. Et je n’ai pris qu’une seule photo. Cette dame m’a ému.
Je n’allais pas chroniquer sans vous parler des gens.
Parce que c’est là l’essence même du voyage.
Oubliez les volcans, les temples et les rizières.
Si je n’avais qu’à garder qu’une photo de Java, ça serait celle-là.
Parce que les autres photos n’auraient aucune valeur si ce pays n’était pas habité. Si ces personnes n’en faisaient pas partie.
Joyeux Noël et paix sur terre aux hommes et aux femmes de bonne volonté.
Billets que vous pourriez aimer
Carte Boni-Bonheur.
 Cette année, j’ai décidé de ne pas faire de carte de Noël.
Cette année, j’ai décidé de ne pas faire de carte de Noël.
C’est ça. Qui est ça. Décision unanime du PDG. Du-Petit-Des-fois-Gros.
Boom. Une autre tradition qui se perd. Encore.
Depuis mes débuts professionnels, il y a maintenant plus de 25 ans, j’ai toujours envoyé des cartes de Noël à mes clients, à mes amis et ma famille. Pour souligner notre alliance. Pour démontrer ma créativité. Pour vous divertir. Pour vous faire rire. Vous faire réfléchir.
Mais aussi, faut l’avouer, pour nourrir mon ego. Cest vrai.
Est cool ta carte. Est belle ta carte. T’es hot. Full likes.
Vous avez été fins avec moi.
Vous l’êtes encore.
Comme client, vous êtes patients. Vous acceptez que ça prenne du temps. Ce foutu processus créatif. Mais aussi ce trop plein carnet de commandes. Vous êtes compréhensifs, fidèles et importants. Vous le savez peut-être déjà, mais je vous le rappelle.
Comme amis, aussi. Tellement. Ces absences. Ces coups de gueule. Ces divergences. Mais cette fidélité. Cet amour. Cette compréhension. Dans la tempête comme au plus chaud des rayons. Plus fort que tout. Vous vous reconnaissez. Pas besoin de vous nommer. Vous êtes toujours là. Dans le mieux. Dans le pire.
Comme famille aussi. Ces enfants si loin. Mais si proches. Fierté mixée à un amour inconditionnel. Ren. Fred. Mom. Isa. Des racines fortes comme la Terre. Des valeurs plus grandes que les océans du monde. Des moments privilégiés volés à nos vies trop rapides. À rire. À pleurer. À s’aimer.
Ben, à tout ce monde-là. Qui forme mon monde à moi. Ben, y aura pas de carte de Noël, cette année. Niet.
Y aura pas de carte, mais y aura pas rien qui ne se fera non plus.
Chaque année, cette carte me bouffe du temps et me coûte de l’argent. Faut trouver l’idée. Rejeter celles qui sont poches. Affiner la bonne. Recommencer. Réaliser. Imprimer. Envelopper. Timbrer. Tout ça dans une période folle où j’ai de la misère à arrêter le temps.
C’est cool. J’avoue. Mais cette année, on va faire quelque chose d’encore plus cool. Beaucoup plus. Et plus utile. On va utiliser cet argent pour allumer autre chose que nos petits plaisirs perso: on va élargir anonymement notre cercle. On va se faire de nouveaux amis. Mais on n’aura pas le loisir de les connaître.
On investit tout cet argent et on la double dans des dons.
À des gens dans le besoin.
Des organismes.
Des fondations.
Du monde.
Des gens.
Dans le besoin.
All in.
Direct. Indirectement.
Anonymement.
Par nécessité. Par plaisir aussi. Pour faire la différence.
Un peu.
Comme on peut.
On transforme notre carte de Noël en carte Boni-Bonheur.
Des points qui feront la différence. Un peu de bonheur. Et qui sait, changeront peut-être des vies.
Merci de votre participation.
Sans vous, ça ne serait pas possible.
Sans vous, c’est peut-être moi qui recevrais ce don anonyme.
x x x
Billets que vous pourriez aimer
Être aimé.
Mes parents partagaient la même date de fête, mais à des années différentes.
Ça m’a toujours facilité la vie. Après le décès de ma sœur, je n’avais qu’à me rappeler d’une seule date dans l’année pour couvrir tous les anniversaires de la famille.
Ne sous-estimez pas la tête de linotte d’un gars : je l’ai oublié à quelques occasions quand même.
Mais pas depuis la mort de mon père.
La petite famille étant devenue un duo familial, je n’ai plus jamais oublié l’anniversaire de ma mère.
Ma mère a 80 ans, aujourd’hui.
Ce n’est pas rien.
On en parlait dimanche, quand je suis passé souper chez elle.
– Je n’en reviens pas, qu’elle m’a dit. 80 ans. Ça n’a pas de bon sens…
Pourtant, ça en a tout plein.
Une belle petite vielle en santé. Avec des bobos, ici et là, mais rien qui ne l’empêche de vivre chez elle, dans sa maison. Une indépendante farouche comme l’était sa propre mère. Je pense avoir hérité aussi de ce trait de caractère. La solitude ne nous fait pas peur. L’angoisse de la maison vide, très peu pour nous. Ça fait râler les amis ou les conjoints, de ne pas être ennuyeux. De ne pas dépendre affectivement. Même si c’est trop souvent amalgamé à un manque d’intérêt pour l’autre. Alors que ça n’a rien à voir.
Ma mère a 80 ans et elle m’aime toujours.
Ça fait drôle de lire ça? Pourtant, c’est le plus beau cadeau qu’elle a pu me faire pendant toutes ces années.
M’aimer.
Tout simplement. Sans flafla.
Malgré les tempêtes, les démissions et les déboires. Quand j’étais loin d’elle. Quand je le suis encore, même si je suis tout près. Ma mère m’aime. Dans les moments les plus sombres, cet amour est cette petite lumière auquel on s’accroche. Le phare dans la tempête.
Ma mère m’aime.
Je ne pense pas avoir été toujours facile à aimer, mais je ne l’ai jamais senti. Son regard calme. Sa voix sereine. Même ado, en faisant de la discipline je n’ai jamais senti autre chose que de l’amour.
Pour quelqu’un qui n’a pas nécessairement une bonne opinion de lui-même, un amour inconditionnel, c’est du fuel de vie.
On pense, à tort que l’amour d’une mère ou d’un père, c’est inné, que ça va de soi, mais ce n’est pas toujours le cas. Les carences d’amour font beaucoup plus mal qu’une maladie. C’est difficilement traitable et ça laisse des séquelles.
Je n’hériterai pas d’un commerce ou d’une fortune.
Mais de beaucoup plus encore.
D’avoir été aimé.
D’être aimé.
Malgré tout.
Billets que vous pourriez aimer
Je suis revenu.
 Je suis revenu.
Je suis revenu.
Encore.
Au pays.
À la maison.
Sur ce blogue.
Je reviens toujours.
Je suis revenu.
Mais pas vraiment.
J’ai l’impression de laisser un petit peu de moi partout où je vais.
C’est peut-être pourquoi je reviens difficilement.
C’est peut-être pourquoi je pars si souvent.
Les voyages forment la jeunesse.
Les voyages déforment la vieillesse.
Les voyages m’enivrent.
Les voyages me font vivre.
Même si je meurs au retour.
Je reviens toujours.
Mais pas vraiment.
En fait, je ne sais pas trop.
En fait, je ne sais rien.
J’ai pourtant l’impression d’en apprendre tous les jours.
Plus j’avance et plus je sais.
J’ai pourtant l’impression de ne rien savoir.
Plus j’avance et moins je ne sais.
Je reviens de voyage.
J’ai les yeux qui chauffent de tout ce que j’ai vu.
Bu. Mangé. Appris. Lu. Envié. Détesté.
Mettez tous les participes passés que vous voulez. Ils y sont tous.
Même ceux que je ne connais pas.
Je les ai peut-être oubliés.
Je les ai peut-être simplement oubliés.
Tout simplement.
Entre deux escales.
Par conviction.
Par lâcheté.
Parce que je sais.
Parce que je sais crissement pas.
Parce que je m’en fou.
Parce que.
Je suis revenu.
Comme à l’habitude.
Ça sentait le pas habité chez moi.
C’était comme quand j’ai quitté.
Le lit défait.
Du lavage à faire.
Un lave-vaisselle plein.
Oui. Oui. Propre le lave-vaisselle.
Mais le reste.
Pas du tout.
Inhabité.
Moins que mon sac à dos.
Y a rien que je n’ai laissé chez moi que j’ai retrouvé avec joie.
Peut-être les livres nos lus.
Que j’aurais trouvé ailleurs.
Anyway.
Plus j’avance, je réalise que tout ce qui importe est dans mon sac à dos.
Je suis revenu.
Avec des comptes pleins la boîte aux lettres.
Au bureau.
Comme à la maison.
Avec moins d’argent.
Moins riche.
Plus riche pourtant.
Je suis revenu sans revenu.
Je suis revenu.
Au Québec.
Oui.
Revenu.
Québec.
Oui, oui je suis revenu au Québec, Revenu Québec.
Je suis revenu.
Plein.
La gueule.
Les yeux.
La bouche.
La tête.
Mais je ne suis pas vraiment là.
Ne le dites pas à ma mère.
Ne le dites pas à mes enfants.
Ne le dites pas à mes clients.
Ni à mes amis.
Mais je ne suis pas vraiment là.
Pas vraiment.
My body is over the ocean.
My body is over the sea.
Oui. Oui. Je sais que la chanson, ce n’est pas my body, mais c’est my bunny.
My bunny is over the ocean.
My bunny is over the sea.
Mais my bunny était avec moi.
Je suis revenu.
Mais quand j’étais ailleurs, j’ai beaucoup pensé à Cricri.
Christine.
Un peu partout où je suis allé.
J’ai eu l’impression de l’avoir amené avec moi.
Je sais qu’elle aurait aimé voyager comme je le fais.
Je le sais.
Elle me l’a dit quand on a soupé ensemble.
Je lui ai dit : tu adorerais. Pis elle as dit : oui.
Mais elle est partie.
Boum.
Sans moi.
Comme dans un clignement d’oeil.
J’ai pris 10 vols d’avions en 20 jours.
J’ai passé les nuages 10 fois.
En 20 jours.
J’en ai vu des invitants à l’envier de s’y coucher dedans.
J’en au vu des noirs à la plaindre de s’y vautrer.
Je n’en ai vu aucun où elle était.
Je suis revenu.
Mais elle n’est toujours pas là.
Et elle n’y sera jamais plus.
Et moi, je repartirai.
Je repars toujours.
Et je reviendrai.
Je reviens toujours.
Mais elle ne sera jamais là.
Jamais.
C’est beau la vie.
C’est poche la vie.
C’est beau la vie quand tu parcours le monde.
C’est poche la vie quand elle n’y est pas.
Je suis revenu.
Mais Cricri n’y est plus.
Mais moi je suis là.
Même si j’y suis pas.
Mais, je reviens toujours.
Toujours.
Billets que vous pourriez aimer
Cottonnelle®
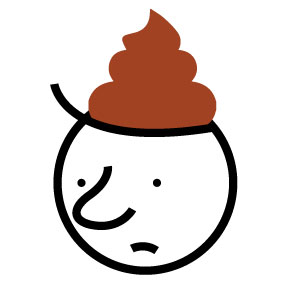 Hier, j’ai ouvert mon iPad pour écrire un peu.
Hier, j’ai ouvert mon iPad pour écrire un peu.
En voulant revisiter quelques brouillons, j’ai réalisé que, pouf, ils avaient tous disparu. Où? Je n’en sais rien.
Une trentaine de textes. Des idées. Des mots alignés. Des mots perdus. Disparus dans les nuages. Dont un texte plus important, de plus d’une cinquantaine de pages. Un début de roman. Un squelette. Une galette écrite y a plus de 6 mois, sous les conseils d’une blonde comète, que j’avais laissé dormir quelque part où seul Apple™ connaît le lieu. Pour y revenir un jour. En vain.
Sur le coup, j’ai paniqué. J’ai fouillé partout dans mon iPad. Redémarrer. Réinstaller.
Mais je n’ai rien retrouvé.
Rien.
En fixant la clignotante barre d’insertion qui me narguait, j’ai fermé le iPad, je l’ai déposé sur sa charge et je suis allé me glisser sous les draps. Résigné. Mais pas découragé. Même pas eu le goût de faire des ricochets de iPad sur le plancher de béton. J’ai fermé les yeux. Et j’ai dû m’endormir dans les secondes qui ont suivi. Les insomniaques ont la fabuleuse facilité à s’évanouir. Pour quelques heures. Malheureusement.
Je pense qu’il n’y a jamais rien qui arrive pour rien.
Oubliez tout aspect de résilience de ma part : ce texte était de la merde. Tout simplement. De la crotte sur le papier. Juste bon à jeter. Dans les nuages. Des mots dans le Cottonelle®. Normal qu’il aie été flushé quelque part entre Chicoutimi et Cupertino.
C’est mieux comme ça.
Facile de penser que ce qu’on fait est toujours édifiant. C’est rassurant. Mais c’est se mentir à soi-même. Y a des jours où il faut seulement réaliser qu’on a fait fausse route. Qu’on était pas à la hauteur.
Je suis dans un métier qui me le rappelle souvent.
Je n’aime pas. C’est mauvais. C’est de la merde.
Ça ne me plaît pas. Ce n’est pas ce que j’anticipais. Vous êtes dans le champ.
Bon, c’est rarement aussi direct. Les clients ont souvent plus de tact, mais ça veut dire la même chose : tu t’es planté. Ne tournons pas autour du pot. Laissons de côté les points positifs, si vous voulez. Ne m’épargnez pas. SVP. Il n’y a rien de pire que de ressortir du positif d’une merde. Votre concept, c’est de la merde, mais y a des points positifs à retenir. Ha oui?
Venez pas m’secourir. Venez plutôt m’abattre. Pour m’empêcher d’souffrir.
De la merde. Je vous dis. Flush. Bye bye M.Hankey.
Désabusé? Pas une minute. Je suis détaché. Tout simplement. Je sais faire la différence entre ce que je suis et ce que je fais. L’auteur et l’oeuvre. Être capable d’humilité est une grande qualité. Pour un artiste, un effort.
Y a un côté positif de se retrouver devant la page blanche de mon iPad. Le champ libre. L’idée que tout est à inventer. Les doigts crispés devant cette clignotante barre d’insertion que je nargue à mon tour. Comme un coureur qui attend le coup de feu. Prêt à exploser sous les starting-blocks.
À espérer le meilleur.
Et la merde, aux autres.
Billets que vous pourriez aimer
La vie des autres
Certains la veulent tracée sur une autoroute balisée avec de l’asphalte neuf, des arbres en plastique et des arrêts prévus pour faire pipi. D’autres empruntent des chemins hasardeux, peu éclairés, parsemés de nids de poule, quitte à faire pipi sur le bord de la route. Certains veulent que ça brasse. D’autres, le moins possible. Certains se posent des questions à l’infini sans y répondre. D’autres ont toutes les réponses, même aux questions qu’ils ne se posent jamais.
Mille-et-une façons de vivre. En famille. Seul. En couple. Mal marié. Veuf. Reconstitué. Destitué. Décimé. Traditionnel. Mixte. Dispersé. Divisé. Autant de modèles que de gens différents.
La vie est belle. Surtout la sienne.
Celle des autres? C’est moins limpide.
Les médias sociaux sont une fantastique fenêtre pour réaliser à quel point, la concept de vie est relatif à chacun. Que les différents types d’existence se croisent et s’affrontent. La sempiternelle notion des bons et des méchants.
Soi. Et les autres.
Y a ceux qui vivent une vie qu’ils détestent, mais qui ne font rien pour la changer. Continuant à se mentir à eux-même, une errance à égrainer des jours qui ne reviendront jamais. À croire à ce bonheur édulcorée, même si c’est une matière synthétique sans goût qu’ils continuent d’ingurgiter chaque jour.
Il y a ceux qui jugent que leur façon de vivre est un exemple. Que les autres font fausse route. Un modèle unique. Sans failles. Un bonheur à sens unique.
Il y a ceux qui vivent par procuration. Abonnés aux vies des autres. Se gargarisant du malheur des uns. Se méfiant du bonheur des autres. Prophètes de malchance, partageant à qui mieux mieux leur pernicieux venin à défaut de vivre leur propre et souvent triste existence. Faut pas se leurrer, les gens qui s’occupent plus de la vie des autres que de la leur, sont avant tout malheureux. Se délecter des épreuves des autres n’est-il pas le geste le plus abominable qui soit?
Il y a les gérants d’estrade. Qui n’ont pas d’enfants, mais des idées arrêtées sur la façon de les élever. Qui n’ont jamais eu à vivre de deuil, mais qui jugent que les gens s’apitoient sur leur sort. La vie des autres dérange. Surtout quand elle est différente de la vôtre. Ou qu’elle vous fait envie. C’est plus facile de détester un truc que vous pensez inaccessible que d’admettre qu’au fond de vous, vous le désirez.
Ma vie n’est pas mieux que la vôtre. Elle n’est pas pire non plus.
Mais c’est celle que j’ai choisi. Un peu.
La vie des autres, c’est surtout l’avis des autres.
Par rapport à soi.
Je n’en ai rien à foutre de la façon dont vous vivez votre vie.
Laissez la mienne tranquille.