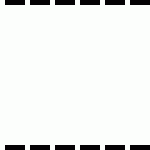Chroniques vietnamiennes
Je n’avais rien écrit depuis des mois.
J’étais absent.
Mais pas loin.
Dans ma tête.
Y aura fallu que j’aille ailleurs.
Beaucoup plus loin.
Pour réapprendre à aligner les mots.
Merci Vietnam de m’avoir redonné le goût de raconter.
Merci aussi pour tes sourires.
Merci pour ta bouffe.
Cảm ơn.
Voici en vrac, les clins d’oeil envoyés sur Facebook pendant mon séjour.
Les lieux n’ont peu ou pas de rapport avec le texte, sinon d’indiquer où ceux-ci ont été écrits.
 Hanoi.
Hanoi.
Il y a longtemps que j’ai réalisé que l’insomnie n’a rien à voir avec le sommeil. En plein décalage de 12 heures, j’avais les yeux ouverts à 4h30.
Il y a juste trop de trucs dans cette petite tête-là.
J’en ai profité pour enfiler mes saucony et un mérinos pour aller voir comment se réveillait Hanoi.
J’ai couru mes premiers kilomètres parmi les balayeurs et les petits kiosques de bouffe de rue qui se préparaient à recevoir les clients. Direction Ho Hoam Kiem. Ce lac / parc à la limite de la vieille ville. Autour des petits vieux et des plus jeunes qui s’affairent à la danse aérobique, à la course, au badminton et au yoga.
Les endorphines, c’est une belle dope. J’ai halluciné en voyant mon père, à travers cette brochette de petits vieux synchronisés sur leurs mouvements. Je me suis dit qu’un danseur en ligne pouvait très bien se réincarner en vietnamien et faire du thaï chi. En plus y avait la même grandeur qu’eux. Je n’ai pas pris de chance et je les ai tous salués quand je les croisais. Au cas.
Courir dans une ville étrangère, c’est le bonheur total. Tu respires les odeurs de la ville à pleins poumons. L’odorat en voyage, c’est plus tripant que la vue. Et plus vrai. Tu peux camoufler que tu es laid avec tes lunettes, mais un parfum cheap ça ne ment pas.
Et j’ai couru. Couru. En faisant des thumbs up, en répondant à des high five. Pas de barrière de langue dans la transpiration.
La vie comme la course, ce sont des kilomètres parfois faciles et plus difficiles. Des détours et des chutes. Quelques blessures. Mais c’est avant tout une aventure non linéaire.
Assis sur un banc, en mangeant une banane achetée à une marchande, devant la beauté du soleil qui se levait, sur la musique et les bras tendus au ciel des sportifs, j’ai versé une larme.
Y’a pas que le malheur qui faut pleurer.
Hanoi (2).
90 millions de Vietnamiens. Divisé par deux roues.
Divisé par deux roues.
45 millions de scooters.
Sérieusement.
C’est le nombre de scooters sur les routes du Vietnam selon la gentille Tam qui nous guide en route pour Along Bay.
Un scooter c’est un véhicule muni de deux trucs à la fois indispensables et détestables: un silencieux dégageant un mazout qui brûle la gorge et un klaxon dégageant un bruit strident qui brûle l’oreille.
À Hanoi, ils ressemblent à des spermatozoïdes en route de fécondation. Ils se dépassent, se mêlent, s’entremêlent et parfois se cognent. Chaque jour, j’ai vu un accrochage, dont un avec une chute assez brutale.
Un scooter, comme une fourmi, transporte 1000 fois son poids : j’ai vu des caisses empilées, des sacs empilés et des familles empilées sur deux roues.
Avec autant de conducteurs, il faut des casques. Beaucoup de casques. Des casques pour tous les goûts: rose pimpant, d’armée, hello kitty.
Même si le casque est obligatoire, on voit quelques têtes nues, ici et là.
Même si les rares lumières tombent au rouge, on voit quelques têtes folles les ignorer.
La valse des scooters et des voitures dans les rues d’Hanoi fait danser les piétons.
Il faut accorder son pas à tout le monde pour traverser une rue. Ne surtout pas arrêter ni hésiter. Un Tetris urbain ou chaque pas te fait prendre ta place sur la chaussée.
Et si un klaxon te détruit le tympan, c’est uniquement pour t’avertir de sa présence.
J’avais remarqué; tu viens de me rouler sur le pied.
 Hanoi (3).
Hanoi (3).
En voyage, je suis en mode observation.
Toujours.
J’essaie un peu de comprendre, mais rarement de juger; je me contente de regarder.
L’architecture. Les affiches sur les murs. Ce que les gens mangent. Comment.
Mais je regarde beaucoup les visages.
Beaucoup.
Je suis physionomiste.
Je regarde tous ces visages différents.
Les yeux. Les bouches. Les cheveux.
Et comme j’ai pas mal d’imagination, je fais toujours des associations bizarres dans ma tête.
Les ressemblances me fascinent.
Je vois des gens que je connais, des comédiens, des animateurs télé dans tous les pays que j’ai visités.
Je sais que c’est un peu tordu.
J’imagine que je le suis.
Hier, j’ai vu 3 de mes amis sur la rue.
Dans les traits de 3 vietnamiens.
J’ai aussi aperçu le comédien Gilles Pelletier dans les traits de cette vieille dame sympathique dans le bouiboui où j’ai acheté de l’eau. Elle a gentiment accepté de poser pour moi – c’est elle, la photo.
Ça me fait rire tout seul. De penser qu’à des milliers de kilomètres, il vit des gens aux vies totalement différentes des nôtres, mais avec les mêmes traits de visage. Aux yeux légèrement plus en amande, mais avec la même vivacité, la même tignasse indomptable et le nez pointu qui visent le ciel.
Ça me fait rire et ça me plaît de penser qu’on n’est pas si différents les uns des autres, finalement.
À quelques degrés de couleurs ou d’angles.
Qu’on recherche à peu près toute la même chose.
Un peu de bonheur. Un peu d’amour.
Et que le vie soit plus facile.
 Baie d’Along.
Baie d’Along.
Hi, my name is Marc. I am a French Canadian and yes, it’s my first time in Vietnam, i am here for food and fun.
Osti que j’hai ça.
J’ai l’impression d’être dans un rdv de AA dans un sous-sol d’église. À me déshabiller pendant qu’on me scrute des yeux.
Mais je suis dans un bus qui m’amène à Along Bay. J’embarque sur un navire dans 3 heures.
Une croisière organisée. De deux jours.
C’était plus simple comme ça pour aller visiter ce coin-là.
Alors faut passer par le trip de groupe.
Je déteste ça.
Pour moi, c’est l’antithèse du voyage.
Ce qui doit être liberté, feeling et nouveauté est éteint par l’horaire, le groupe et la promiscuité.
Y’ à longtemps que je sais que le voyage m’apporte ce côté anonyme qui me plait tant. Un étranger dans une ville étrangère qui déambule au gré de ses narines, ses yeux et ses pieds. Pas pris en charge par un géo (bien qu’ils soient les plus gentilles personnes du monde). Et je ne juge personne en disant ça. Chacun son trio. Certains ont besoin d’un horaire. D’autres pas.
Pas donné à tout le monde de partir à l’aventure. Certains la préfèrent organisée leur aventure. C’est leur droit.
Il y va de la vie en général.
Ça rassure la plupart des gens de calculer les années d’ancienneté. De détester les changements. De vouloir planifier leur vie à tout prix.
Je suis comme cette vendeuse itinérante à Hanoi.
Je suis de ceux qui ne savent pas ce qui les attend. Je travaille pour arriver à une fin, mais je ne sais pas laquelle.
Et c’est parfait comme ça.
 Hué.
Hué.
Louis Vuitton. Hugo Boss. Lacoste. North Face. Nike. Nommez-en des brands connus.
Ils sont tous disponibles dans la rue à des prix dérisoires.
On voit ça partout.
On se fait offrir des copies de marques à New York, Barcelone ou Montréal.
Surtout par des particuliers, sur le trottoir, à la sauvette.
Mais ici, la copie de marques prend des proportions incroyables. C’est du sérieux. On s’affiche. Les boutiques ont pignon sur rue. Avec logos, posters et tout le tralala. On copie non seulement les produits, mais tout autant leur mises en marché.
Quand tu as l’œil aiguisé, tu remarques facilement la supercherie. Le logo souvent trop gros sur le vêtement et la qualité du tissu laissant à désirer.
Sauf qu’au Vietnam, on a affaire à des pros. Et ça ne se joue pas seulement sur les vêtements. Je lisais qu’il existe une maffia hôtelière. Quand un hôtel ou un restaurant ont du succès sur Trip Advisor ou sur Booking, on va ouvrir un commerce du même nom. Pour s’approprier le succès. Et les clients.
Impressionnant.
Mais pas toujours réussi.
Comme cet hôtel Google, découvert par hasard, en marchant à Hué.
 Hué (2).
Hué (2).
Vedette propulsée par Anthony Bourdain, dans son émission Parts Unknown, cette gentille dame m’a servi un de mes meilleurs repas au Vietnam (à date…). Bún bò Huế que ça s’appelle. Et comme son nom l’indique, on en mange seulement à Huế. On en trouve partout sur les rues, mais il faut aller s’assoir au milieu du marché Dong Ba, sur son petit banc de plastique et recevoir son plat par elle pour la savourer à sa juste valeur. Une délicieuse soupe au bouillon de porc et bœuf, vermicelle, morceaux de viande, boudin et herbes. Arrosé de chili, c’est le paradis. Et l’enfer pour le cul. Une bière chaude qu’on sert dans un verre où on ajoute de la glace, quelques brochettes à la citronnelle et tu dis: je suis vraiment rendu au bout du monde pour manger ça. Ouais. Et chaque bouchée te donne raison de l’avoir fait.
 Hoi An.
Hoi An.
Il devait mesurer deux fois ma grandeur. Un grand Australien de Melbourne aux allures de nageur olympique. Il s’est assis à côté de moi, sur un petit banc de plastique qui sert de set de cuisine dans les restos pas de restos que sont le marchandes de nourriture de rue. On a échangé quelques trucs usuels de backpackers : t’arrives de où, tu vas où, tu viens d’où.
En voyant, la dame enfiler un piment chili entier dans une galette de riz avec une brochette de porc à la citronnelle et me la tendre, il me dit : wow, you like spicy food, men…
Ouais, pas à peu près.
En pointant du doigt son épaule tatouée IronMan, je lui demande s’il savait que manger épicé, tout comme le sport, générait une bonne dose d’endorphine. Que les piments forts, c’est comme de la dope pour le palais.
T’en veux toujours plus, et tu veux toujours aller plus loin.
Ha? Cool, qu’il me dit. En voyant la dame, lui en mettre deux, dont un rouge dévastateur, il a pas bronché et commencé à bouffer.
T’es accro à l’endorphine ou tu ne l’es pas.
Je me suis levé en le saluant, réalisant que j’étais quasiment sa grandeur, mais qu’il était encore assis.
Quand je l’ai quitté, il avait enlevé sa casquette pour laisser sa tête respirer un peu. Son front dégarni suintait. Sa bouche était légèrement plus molle. Sa diction à peine audible.
À l’heure qui l’est, il doit certainement faire des longueurs de piscine, la bouche ouverte.
Je ne sais pas s’il a eu le même buzz qu’à l’arrivée de son 42km, mais je sais qu’il va se souvenir de moi.
Du moins, demain matin.
 Can Tho.
Can Tho.
50 millions de Vietnamiens
Et moi, et moi, et moi.
Chantait Dutronc en 1966.
Aujourd’hui, ils sont plus de 90 millions.
Le Vietnam, comme le reste de l’Asie, compte des habitants aux pouces carrés.
Une promiscuité incontournable et palpable.
Chaque route est partagée.
Chaque habitation.
Souvent le lit aussi.
Il faut voir les lits communs dans les minuscules appartements. Cette grande surface plane où s’aligne toute la famille pour dormir.
Du bébé à l’arrière-grand-père.
Pas partout, bien sûr.
Comme chez nous, il y a les mieux nantis. Avec maison, chambres séparées, salle de bain complète.
Et il y a les plus pauvres qui s’empilent les uns sur les autres.
Les comportements des autres peuples se confrontent toujours aux nôtres. C’est normal. Faut juste pas tracer une ligne sur ce qui est bon ou pas. Ça serait trop facile.
Nos réalités sont si différentes.
Ici, pour un étranger, il n’est pas rare de se sentir bousculé. Sur la rue, c’est chacun pour soi. Prends ta place. Personne ne cèdera la sienne. Tout ça, se fait sans agressivité, bien sûr. Quand une personne en coupe une autre sur la route ou dans une file, il n’est pas question d’enlever quoi que ce soit à l’autre. Ça se fait de façon naturelle. Sans malice. Je revendique cet espace. Et chacun trouve le sien.
Comme ce petit bonhomme à Hanoi.
90 millions de Vietnamiens
Et moi, et moi, et moi.
 Ho Chi Minh Ville.
Ho Chi Minh Ville.
«Je m’appelle Khué. J’ai vingt et un ans. Devant moi la vie. Je veux y croire – à moi de l’inventer. »
C’est dans le roman de Nguyen Huy Thiep que je lis présentement.
Avec plus de 30% de sa population en bas de 18 ans (contre seulement 5% âgée de 65 ans et plus), le Vietnam est un vieux pays rempli de jeunes.
Pas besoin de lire plein de statistiques pour le réaliser. Il suffit d’ouvrir les yeux. Ils sont partout.
Attablés au resto du coin à boire un thé, en crachant des graines de tournesol sur le bitume. Ou à manger, comme sur cette photo prise à Hanoi. Ils sont sur des scooters. Ils sont au travail. Au karaoké. À l’école. On les voit partout.
Coincés entre les vieilles traditions familiales et le tourbillon d’une culture mondiale qui les influencent aussi.
Avec la valeur du nombre, on peut définitivement changer les choses.
Et ils le savent.
On l’a vu dans les pays occidentaux.
Dans un reportage de Thalassa, visionné avant mon départ, sur Ho Chi Minh, des jeunes s’exprimaient sur leurs réalités et leurs ambitions.
À vouloir avancer. À vivre.
La force de la jeunesse n’est-elle pas concentrée dans ses rêves?
 Îles de Con Dao.
Îles de Con Dao.
Quel jour on est?
Aujourd’hui.
L’heure?
Celle de manger.
Ou de dormir.
Je ne sais pas.
J’ai perdu la notion du temps.
Tout autant que mes repères.
Je suis sans balises.
J’habite un sac à dos.
Mes vêtements ont des plis.
Autant que mon visage.
Je suis un facteur humidex.
Ambulant dans la ville.
J’erre entre les scooters.
J’anticipe leurs courses.
J’ai les jambes blanches.
Une face de racoon.
Des bras d’habitant.
Je prends des bus.
Des vélos.
Des taxis.
Des avions.
Des trains.
Mes sandales.
Je prends toujours mon pied.
Je n’ai aucun sens de l’orientation.
Mais j’ai celui de l’humour.
Je me perds.
Aussi dans ma tête.
J’écris sur un iPhone.
Je fais des fautes.
Mais, je me pardonne.
Je mange trop.
Je bois trop.
Je mange des trucs mous.
Du croquant.
Des saveurs subtiles.
D’autres, agressantes.
Rarement douces.
Je ne mange jamais dans des restos.
J’avale de l’asphalte.
Je mange la rue.
Aussi des yeux.
J’ai des larmes quand c’est piquant.
Quand c’est drôle.
Quand c’est beau.
J’écoute les gens sans comprendre.
J’essaie de comprendre leurs vies.
Je suis de nulle part.
Je suis d’ailleurs.
Les villes changent de noms.
Je les prononce mal.
Je n’ai pas peur du ridicule.
Ni de l’autre.
Un peu de moi.
J’ai survolé l’eau.
Je suis sur une île.
Pas déserte, mais presque.
Sur un caillou dans l’eau.
Minuscule.
Sur un globe terrestre, on la voit.
Mais elle est trop petite pour y mettre son nom.
Même si ce n’est que 6 lettres.
Con Dao.
Jadis, une île avec prisons.
Aujourd’hui, j’y viens pour m’évader.
Tout petit la planète.
 Îles de Con Dao (2).
Îles de Con Dao (2).
«Souriez toujours, car le sourire est le seul langage que tout le monde comprenne.»
Tiré du film Human de Yann Arthus-Bertrand, cette phrase m’a complément séduit quand je l’ai entendu.
Et y a que ça de vrai.
À l’autre bout du monde.
Comme au coin chez vous.
Si vous voyagez et que la langue est une prison, vous avez une petit clé juste sous votre nez.
Un sourire.
Être courtois.
C’est si simple.
Prenez, ces touristes français croisés la veille du jour de l’an à Ho Chi Minh. Grossiers, tonitruants, des Elvis Gratton en vacances.
Comment peut-on s’imaginer une petite minute qu’on vous répondra comme il se doit, si vous agressez votre interlocuteur. Ces réflexes colonialistes de touristes me gênent toutes les fois. Je fuis les endroits où ils s’agglutinent. Je déteste les entendre raconter leurs âneries de comparaison entre leur culture et celle de nos hôtes.
Je préfère de loin, la candeur.
De ceux qui s’émerveillent à voir du nouveau. À goûter ces trucs pas toujours bons, mais différents. Ceux qui essaient de baragouiner des mots dans une langue qui n’est pas la leur.
Quitte à avoir l’air fou.
Souriez.
Et voyez ce que ça fait.
La réaction est immédiate.
Oui, il se peut qu’on ne vous le retourne pas.
Mais ce n’est pas grave.
Vous venez tout de même d’annoncer que vous êtes gentil.
Et ça, ça donne beaucoup de possibilités.
Comme celle de photographier ce jeune marin au port de Con Son.
 Ho Chi Minh Ville (2).
Ho Chi Minh Ville (2).
«Je n’ai pas l’intention de me proclamer explorateur. Je ne veux ni conquérir les sommets vertigineux ni braver les déserts infernaux. Je ne suis pas exigeant. Touriste, ça me suffit.
Le touriste traverse la vie, curieux et détendu, avec le soleil en prime. Il prend le temps d’être futile. De s’adonner à des activités non productives, mais enrichissantes. Le monde est sa maison. Chaque ville, une victoire.»
J’aurais aimé écrire ça.
Mais c’est de Julien Blanc-Gras.
Du livre tout écorné qui est dans ma valise. Ce livre a fait 6 pays différents avant que je l’ouvre, ici, au Vietnam.
En voyage, je choisis méticuleusement les romans qui m’accompagnent. Celui-ci a fait plusieurs aller-retour sans être ouvert.
C’est comme ça.
Je ne sais pas pourquoi.
Alors il s’est ramassé tout écrasé dans mon sac, avec des pages pliés, une odeur d’humidité et des tâches sur la couverture, sans avoir eu le loisir de me divertir, enrichir ou simplement me faire oublier les heures perdues dans les aéroports.
Justement, j’écris d’une banquette bleue en cuirette, conçu par un designer sans fesses.
Je me suis payé une eau minérale à un prix démesuré.
En attente d’un vol pour Siam Reap.
Au Cambodge.
Touriste, ça me suffit.
Je vous dis.
 Siem Reap, Cambodge.
Siem Reap, Cambodge.
Elle devait avoir autour de 8 ans.
Je ne suis pas très bon pour deviner les âges. Peut-être parce que je voudrais oublier le mien. La grandeur, ces visages souriants, cette peau plus laiteuse font que c’est encore plus difficile avec les Asiatiques.
C’était une enfant.
Comme ces douzaines qui nous prennent d’assaut autour des temples d’Angkor, à Siem Reap au Cambodge.
À nous vendre des cartes postales, des fruits ou de l’eau.
Oui, ça crève le cœur.
Oui, même s’ils font du commerce, tu es incapable de ne pas penser que c’est une sorte de mendicité.
Qu’il y a exploitation. Qu’il y a quelqu’un qui commande. Qui en tire profit. Papa? Maman? Ou quelqu’un d’encore moins proche.
On sait tout ça.
La petite m’a demandé si je voulais des sucreries.
Candy?
Non merci.
Candy?
No.
No.
C’est dur de dire non.
D’être ferme en plus.
Surtout que ce n’est que quelques dollars.
Voyant que je l’ignorais elle est revenue à la charge.
Boom Boom?
Boom Boom, mister?
J’ai eu un blocage.
Un arrêt cardiaque.
Qu’est-ce que tu dis?
Boom boom…
Ça, c’est ce que les chauffeurs de moto taxi offrent aux gars seuls qui marchent le soir.
Ladies boom boom, mister?
Des prostituées.
On les vire ces pimps à moto ou on les ignore et ils cherchent d’autres clients.
Mais toi petite?
Pas toi.
No.
J’ai eu un arrêt cardiaque.
Un frisson.
Un grand malaise.
Je vais te donner des sous.
Pour une photo, que je lui dis.
Elle a regardé l’objectif.
J’ai fait clic.
Et j’ai continué ma route.
Incapable de supporter son regard.
Incapable de m’enlever de la tête ces deux mots venant d’une fillette.
Cette photo me hante depuis que je l’ai prise.
Ces yeux noirs.
Aussi noire que la nuit.
Les enfants sont toujours les victimes.
Car ils subissent les décisions des autres. Sans pouvoir se débattre.
Ils ne décident pas de la pauvreté. Leurs parents non plus, mais leurs statuts de parents leur donne une latitude que l’enfant n’a pas.
Au bout du monde comme chez nous.
On pense immédiatement aux siens.
À ses enfants.
À cette injustice.
Ce matin au Cambodge.
Au temple Banteay Srei.
Le Temple des femmes.
Mon cœur à fait boom boom.
Pour cette petite.
Et pour tellement d’autres dans ce monde souvent si croche.
Billets que vous pourriez aimer
Facebeurk.
Fuck you.
Meurs.
Tu mérites que ça.
Criss de con.
Il est beau notre monde.
Surtout dans les médias sociaux.
Facebeurk. Twitteurk.
140 mauvais caractères. 50 nuances de brun.
Tous ces propos dénigrants. De part et d’autre. Toute cette agressivité de moins en moins retenue. Des mots à saveur de vomi. Des dialogues de violence. Du vitriol sous la langue. Des mots qui frôlent plus les fesses que l’esprit. Tous ces propos absents d’intelligence.
Et tout ça au prix de la vérité.
Ho bien oui.
Parce que c’est bien de ça qu’il est question. La vérité.
Vous la détenez tellement qu’elle vous donne le droit de la cracher à la gueule du premier qui vous contestera. Vous videz de pleins chargeurs de propos haineux sur les gens qui osent avoir une opinion différente de vous. Vous les abattez au prix de votre vérité.
J’ai le droit de te traiter de con. Parce que j’ai raison. Et pas toi.
Toute cette haine me dégoute. Tout ce dénigrement justifié.
Ce n’est pas les idées différentes des miennes qui me font capoter. C’est de la façon dont vous les exprimez. Cette manière désinvolte de désamorcer la violence. De la légitimer. Mes idées sont tellement nobles que j’ai droit de te les chier dessus. J’ai tellement raison que c’est normal de traiter de tête de noeud. Vraiment?
Je me rappelle la première fois où j’ai aperçu une affiche, près d’une caisse dans un grand magasin, qui disait qu’aucune violence verbale ne serait tolérée. J’avais été surpris. Faut vraiment écrire ça? Faut vraiment rappeler aux gens, l’importance de communiquer de manière polie? Faut rappeler aux gens qu’une serveuse de restaurant n’est pas l’unique raison d’un retard, qu’elle fait partie d’une chaîne et que de s’en prendre à elle quand ça se bouscule en cuisine, ne règle rien. Faut vraiment rappeler aux gens que le caissier qui te fait payer n’a aucun pouvoir sur le prix de l’objet que tu achètes et que le vilipender n’en fera pas baisser le coût.
À la blague, quand je suis au volant de ma voiture et qu’un automobiliste me dépasse de façon abrupte, je fais souvent semblant de lui crier : hey le sauvage, tu ne sais pas vivre!!! Ça me fait rire. De penser que mon intervention n’est pas plus brillante que son geste.
Nous vivons une époque de cynisme qu’on attribue trop facilement à de la critique constructive.
Internet pullule de sites de parodies. Ridiculisant les gens à gauche et à droite. Souvent des grossièretés rendues sous le couvert de l’humour. L’humour pardonne les propos injurieux. «Mange de la marde, madame, va chier, madame, c’est une joke, madame» parodiait Paul et Paul (Claude Meunier, Serge Thériault et Jacques Grisé) dans leur disque Remi AM/FM. C’est une joke, madame. Ris. Même si je t’envoie promener. Comme flatter avec un gant de crin. C’est toujours plus drôle de rire des autres que de soi.
Le désabusement face à la société rend les gens intransigeants entre eux. On n’est plus au niveau des idées, mais de celui de qui te les poussera le plus loin dans la gorge. À coups de tabarnac de con. À coups de vérité absolue.
Je pense que la violence est l’arme des faibles.
Je pense que l’injure est un manque d’arguments.
Je pense qu’haïr les gens te fait plus de tort à toi-même qu’à ceux que tu hais.
Je pense que l’ultime vérité n’existe pas.
Je pense qu’une langue dans le vinaigre, c’est simplement dégueu.
Billets que vous pourriez aimer
Des mots qui frappent plus qu’une cuiller de bois.
 Enfant, je n’ai jamais subi de violences de la part de mes parents.
Enfant, je n’ai jamais subi de violences de la part de mes parents.
Ni physiquement. Ni en paroles.
Jamais fait traiter de noms. Jamais reçu de claques derrière la tête. Ma mère m’a raconté qu’un jour, elle m’a donné une tape sur les fesses, mais que c’est elle qui avait pleuré. Moi, je ne me rappelle de rien. Ça donne une idée des séquelles que j’en ai gardé.
Mes parents étaient fermes et autoritaires sans toutefois être trop sévères. En fait, mon père parlait peu. C’est ma mère qui faisait la discipline. L’absence de parole du paternel était pourtant beaucoup plus inquiétante: elle nous faisait craindre le pire. S’il fallait qu’il parle. Watch Out. Ma mère, comme bien des mères des années soixante-dix nous servait, à ma sœur et moi, lorsque nous étions turbulents le classique «attendez que votre père arrive». Ces cinq mots avaient l’effet d’arrêter le temps. D’assombrir le ciel. Soulever le vent. Balayer les feuilles mortes. On pouvait apercevoir la tempête venir de loin. Non! Maman, pas ça!!! On arrête, promis!!! La crainte fait souvent plus mal que le réel.
C’était un des deux trucs ratoureux de ma mère. Elle ne disait jamais rien à mon père, mais on ne courait pas le risque. Au cas. On roulait sur la peur. Sur l’inattendu.
Son autre artillerie lourde, la pire de ses tactiques de destruction massive je dirais, celle qui me faisait fondre le coeur comme glace au soleil était de balancer la phrase «Marc, tu me déçois tellement…»
Ouch.
Décevoir. Sa propre mère. Ses parents.
Tu fais une connerie, OK. Tu n’es pas fier, OK. Tu risques une punition, OK. Si la faute est si grave, une claque derrière la tête, OK. Mais pas ça. Pas se faire dire : tu me déçois. Non. Pas ça. Frappe-moi. Tiens, la cuiller de bois. Non? Tu ne veux pas? Siouplait. Ça ferait moins mal.
Pas de farces. Bien sentie, cette phrase, à elle seule, avait le pouvoir de rendre dociles, les gringalets d’adolescents que nous étions.
Je me rappelle un voyage de gars en auto, où nous racontions des anecdotes de jeunesse. Trois gars dans leur milieu de quarantaine qui exprimaient unanimement comment cette phrase pouvait avoir l’effet d’une bombe quand elle leur était crachée par une personne aussi importante que sa mère ou son père.
Décevoir.
Décevoir les gens importants à ses yeux.
Le degré d’importance de la déception engendrée est égal à l’importance que vous attribuez à la personne que vous décevez.
Un compagnon de travail vous dit qu’il est déçu par l’horaire que vous avez établi. Bof. Un client se dit déçu de ton service, ça dépend de la relation que tu entretiens avec celui-ci. Mais si un de tes proches amis se dit déçu de ton attitude quand tu fais un truc. Ça vient te chercher. Directement. On n’aime pas décevoir. À moins d’être complètement détaché ou insensible aux répercussions de ses propres actions, ce qui est plutôt rare quand on respecte la personne à qui l’on s’adresse.
J’ai encore beaucoup de misère à gérer les déceptions autour de moi.
Les gens que j’aime et qui m’entourent ont cette facilité à me faire sentir mal quand je pense que je les déçois par mes paroles ou mes agissements. C’est fou, hein? Encore aujourd’hui, avec le bagage acquis et la maturité, je fonds comme un petit kid qui se fait prendre la main dans le sac.
Est-ce bien, est-ce mal? Je n’en sais trop rien. Donner aux autres, même si précieux soient-ils, autant de latitude sur soi est téméraire. Comme donner sa carte de crédit, son NIP et les trois chiffres vérificateurs, en disant : sers-toi, y a pas de limite, anyway. Donner la clef de voûte de son coeur. À manipuler avec soin.
Ça vous arrive aussi? Vous avez ce principe (où cette tare, ça dépend ou vous créchez dans votre philosophie par rapport aux autres) en vous?
Si vous l’avez, vous me décevez un peu.
Si vous ne l’avez pas, vous me décevez vraiment.
Billets que vous pourriez aimer
Buddy
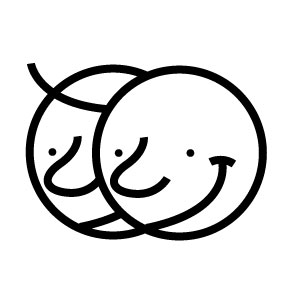 Chiang Mai, Thaïlande. Décembre 2014.
Chiang Mai, Thaïlande. Décembre 2014.
Bing.
Un texto. 8 mots. Une courte phrase.
J’ai souri en lisant.
C’était un message de Buddy. Un message qui voulait dire hey, je suis là. Même à douze heures de décalage. Même à 11614 kilomètres de distance. Un coeur, ça voyage à la vitesse de la lumière.
Buddy, il est comme ça. Tu peux compter sur lui. Tu peux t’appuyer sur lui. Il est fort. Il est présent. Même quand il n’est pas là, physiquement, tu sais qu’il n’est jamais loin.
Un gars que tu embrasses sur la bouche. Que tu serres dans tes bras à la limite de respirer. Avec lui, tu peux rire à t’en fendre la gueule. Tu peux pleurer à t’en fendre l’âme. Dans les moments cools comme les plus plates, il est toujours là. À t’écouter. Les yeux dans les yeux. Un gars qui pleure, c’est beau. Un gars qui te laisse pleurer, sans juger, c’est encore plus beau. Un gars qui pleure avec toi, c’est encore mieux.
Buddy, c’est un chum. Un pote. Un frère.
On dit que les amis, c’est la famille que l’on choisit. Pour moi, qui suis presque sans famille, c’est d’autant plus vrai. D’autant plus important. Buddy, c’est le frère que je n’ai pas eu.
Un ami. Pas imaginaire.
Un ami. Dans sa plus simple définition. Dans ce qui a de plus pur. Pas de flafla. Que du vrai. Pas quelqu’un qui quête de l’amour. Ni qui te fait des reproches quand tu ne l’appelles pas. Pas un vampire qui te tire tout ton sang. Y a pas un odomètre à présences accroché à lui. Tellement pas, qu’on passe des mois sans se parler, s’écrire, où se voir. Et que ce n’est pas plus grave que ça. L’amitié, ça ne se comptabilise pas. Mais ça compte. Et c’est ce qui compte.
Je vous souhaite de rencontrer, vous aussi, un Buddy.
De recevoir un texto quand vous ne vous en attendez pas.
Comme un direct au coeur.
Hey, je suis là.
Je le sais.
Et c’est beaucoup.
Billets que vous pourriez aimer
#50/50
Muet
Comme une carpe.
Rien écrit ici depuis des mois.
J’étais ailleurs. Pas loin pourtant. À l’intérieur de moi. Inside. Une escapade aux allures de grandes expéditions. Aux confins de ses peurs, de ses joies et de ses espérances. Un voyage dans le passé, pour apprécier le présent et préparer le futur.
J’ai fait beaucoup de voyages, mais de se visiter soi-même permet de découvrir un paquet de trucs trop souvent jusqu’alors inconnus. Comme une ville, nous avons en nous des quartiers lugubres malfamés où l’on marche les fesses serrées, mais tout autant des oasis paisibles où l’on se sent bien. Nous sommes des êtres si complexes. Et si fragiles. Tellement. On peut perdre la tête comme un peu simplement si perdre. C’est la dernière option que j’ai choisi avant d’être forcé de choisir la première.
J’aurai 50 ans dans quelques jours.
Vous dire que ça ne me fait pas chier serait de mentir. Je déteste l’idée d’accumuler les jours. De les voir derrière soi défiler trop rapidement. Ça explique peut-être pourquoi je ne dors pas ou si peu. D’avoir l’impression, même fausse, d’étirer le temps comme je peux. De le déjouer. De lui faire un doigt d’honneur. Passe ta route, moi je bouge pas, je fixe le temps.
J’aurai 50 ans et j’ai déjà rencontré tellement de gens intéressants, allumés, différents, drôles, sensibles, impertinents, talentueux, généreux. Des gens que je connais depuis des décennies, d’autres d’à peine quelques heures. Des amis, des parents, des clients, des fournisseurs que je mélange à mon gré, pour créer mon monde. Sweet And Sour. Hey, tu peux pas mélanger cette fille-là avec celle-là, les deux se détestent. C’est ma recette. Pas la tienne. Hors de ma cuisine, bouffe et tais-toi. C’est bon? Je te l’avais dit. Pour qu’un ciel flamboie, le rouge et le noir, ne s’épousent-ils pas disait Brel.
J’ai eu la chance de voir tous les gens qui m’entourent un soir d’octobre. Je n’ai pas la chance d’avoir une discussion avec chacun d’eux, mais j’ai apprécié de savoir qu’ils étaient tous là. Pour moi. Ils ont ma gratitude éternelle. Je les remercie d’être la. Même quand moi, j’y suis pas.
J’aurai bientôt 50 ans. Et ça me fait chier.
Et comme je ne pourrai racheter des années sur EBay (j’ai vérifié…) j’ai décidé de faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Au lieu de faire en sorte que cette journée (ou année) fatidique passe en coup de vent, je vais m’organiser pour la rendre inoubliable.
Mon projet s’appelle #50/50. 50 pour 50. 50 projets pour 50 ans.
Je veux faire 50 trucs, choses, projets, plans que je n’ai jamais fait encore jusqu’à maintenant. 50 situations, aventures, défis qui métamorphoseront une année de merde en or.
Ce voyage en Thaïlande, seul, en est un. J’imagine que dans ce voyage, je réussirai à en faire d’autres. Mais l’année est longue et 50, un criss de gros chiffre. Je le sais trop bien. Alors j’ai besoin de vos suggestions, invitations et idées pour que #50/50 soit mémorable sur toute la ligne. J’ai déjà des projets sur la table : courir un demi-marathon demain à Chiang Mai (ou je me trouve présentement), aller aux Canadiens au centre Bell et être pour UN seul soir, un fan de cette équipe avec tout ce que ça implique comme humiliation. On m’a même proposé poser nu pour une peinture… À suivre.
Je vais avoir 50 ans et ça me fait chier, Et comme je l’aurai qu’une seule fois dans ma vie, pour l’oublier, je vais tout faire pour ne pas l’oublier.
J’étais muet.
Muet comme une carpe.
Comme dans carpe diem.
Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain.
#50/50
Billets que vous pourriez aimer
Mon double.
 Je ne voulais pas d’enfants.
Je ne voulais pas d’enfants.
J’aurai été ce genre de gars là. Je n’avais pas cette fibre paternelle que je détectais chez certains de mes amis. Je me souviens de mon ami Yohan, mon premier coloc, qui m’annonçait fièrement que sa blonde était enceinte. Il était tellement content. J’étais heureux pour lui aussi. Même si je ne comprenais pas ce que représentait ce sentiment de devenir père. J’étais à mille lieues de ça. Avec mes cheveux crêpés, mes bottes d’armée et mes vêtements rapiécés.
Pourtant.
Deux mois après cette annonce, j’apprenais, moi aussi, que tu ferais de moi un papa. Toi, mon fiston. Y’a près de 25 ans de ça, aujourd’hui.
J’ai eu le vertige quand je l’ai su. Une envie de me sauver. À l’autre bout du monde. C’était trop tôt pour moi. Pas prêt pour ça. Non. Je ne voulais pas entrer dans cette ère d’adulte. Je venais à peine de découvrir le monde, la vie et j’avais l’impression que ton arrivée mettrait une fin à une épopée exaltante et déjà trop courte : celle de l’irresponsabilité et de l’égocentrisme.
Je me souviens d’avoir appelé des chums pour leur annoncer la nouvelle. Je n’ai plus vraiment de souvenirs de cette soirée par contre. Noyé dans la bière et les larmes, j’ai parlé de mes peurs de ne pas assumer. Je parlais de la fin. Alors que j’aurais dû parler du début.
Et puis tu es arrivé. En avance. Prématuré. Avec ta face de souris et tes abondants petits cheveux blonds. Minuscule comme une poupée. Tu étais plus dans ma tête, mais bel et bien là. En vrai. En vie. Je me souviens d’être allé l’annoncer à ta grand-mère et ton arrière grand-mère. Tenter de dire, à travers les larmes, toute la beauté de ta naissance. Du choc que j’ai eu en touchant tes petits doigts. De te voir arriver, petit Marc minuscule. Un petit bonhomme qui entrait dans mes deux mains. Je ne pouvais pas te renier. Tu étais mon portrait caché.
Dans ce petit appartement ordinaire qui mangeait tous mes revenus, on s’est débrouillé, ta mère et moi, pour te créer un environnement plus ou moins adéquat. On avait un maigre salaire pour trois, pas d’auto, le minimum de meubles, et nos propres parents qui nous aidaient à te créer un petit chez toi. Facile? Pas vraiment. J’étais comme une balance. Heureux de t’avoir dans mes bras, malheureux du contexte dans lequel tu étais arrivé. Comme si on m’avait catapulté dans une autre galaxie. Autour de moi, je voyais des parents de mon âge plutôt bien nantis; tellement loin de ce que nous vivions, nous, comme famille.
Tu es devenu un petit homme enjoué. Tellement facile à vivre. On a déménagé. Encore et encore. On a acheté une maison. Ta sœur est arrivée. La vie est devenue plus facile, financièrement parlant. Et plus difficile, sous d’autres plans.
Et boum, en plein pendant ton adolescence, on a dû se séparer.
Trop loin. Beaucoup trop loin.
Le gars qui ne voulait pas d’enfant et qui devait maintenant s’en départir en a pris plein la gueule. Contre son gré. Hey. Je n’étais pas fait pour ça non plus, te quitter.
Te dire tout le mal que ça m’a fait. Que ça me fait encore.
Quand je te vois aujourd’hui. Grand. Fier. Droit comme un piquet. Le cœur sur la main. Ouvert aux autres. Toujours présent. Quand je te vois aujourd’hui et que mes bras ont de la misère à faire le tour de tes larges épaules, j’ai un sentiment de fierté incroyable. Tu es devenu tout qu’un homme. Tu es quelqu’un d’exception. Tu as gardé la candeur de tes jeunes années doublée d’une grande maturité. Une belle et grande insouciance contrôlée.
Aujourd’hui, il y a près de 25 ans qui nous séparent. J’ai pourtant l’impression de ne jamais avoir été aussi près de toi. Comme quand tu te couchais sur mon ventre, sur ce divan crado qu’on recouvrait d’un jeté pour cacher les trous. Nous sommes tellement proches. Pas physiquement, mais dans nos têtes. Cette même ligne de pensée. Ces valeurs que l’on partage, toi et moi. Notre caractère. Notre sens du devoir. On se ressemble, même si cette année, j’aurai le double de ton âge.
Plus je te vois et plus je t’admire.
Fier comme un paon.
Fier comme un papa.
Bonne fête, mon gars.
Billets que vous pourriez aimer
Mini-Wheat
 Je suis capable du meilleur. Comme du pire.
Je suis capable du meilleur. Comme du pire.
Gentil comme deux. Teigneux comme pas un.
J’ai autant de caractère que je suis mou.
Je suis de conversation insatiable. Vous chercherez le bouton pause sur ma gueule. Bla bla bla. Introuvable. Je suis aussi muet qu’une carpe. Yeux absents. Silencieux.
Je suis workaholic. Alignant les heures de travail. 12 heures par jour. 7 jours sur 7. Je suis lâche comme un âne. Préférant regarder pousser le gazon, plutôt que de le couper. Une larve.
Je ris à m’en décrocher la mâchoire. Je pleure à m’en fendre l’âme.
Je cours 15 km sans boire. Je bois à être incapable d’aligner deux pas.
J’ai encore des articles de cuisine que ma mère m’a légués quand j’ai quitté le nid familial à 19 ans. Je suis capable de dépenser une fortune pour un gadget que je n’utiliserai jamais.
J’aime le soleil au lever. J’adore m’endormir sous la pluie.
J’écoute de la musique partout : au bureau, à la maison, dans mon auto, en course. J’adore me retrouver tout seul dans le silence.
J’ai des clients qui me trouvent performant. J’ai des clients qui me courent après.
Pour les artistes, je suis en business. Pour le gens d’affaires, je suis un artiste.
Je mange bien. Je mange de la marde.
Je suis de droite, économiquement parlant. Je suis de gauche, socialement parlant.
J’aime aider les plus démunis. Comme je voudrais parfois leur botter le cul.
Je suis d’une simplicité involontaire. Je suis d’une complexité volontaire.
Je suis ici à rêver d’ailleurs. Je voudrais être ailleurs pour m’ennuyer d’ici.
Je ne voudrais pas vieillir. Je ne voudrais pas revivre ma jeunesse.
Je ne m’ennuie pas de mes enfants. Je pleure quand je les vois.
Je suis patient, capable de recommencer un truc des milliers de fois. Je capote à l’idée de refaire la même routine.
Parfois je trouve la vie si lourde. Parfois je constate que le temps passe trop vite.
Je suis trop vieux pour faire ça. Je suis trop jeune pour penser à ça.
Les jeunes m’énervent parce qu’ils ont raison. Les vieux m’emmerdent parce qu’ils ont raison.
Dans une grande ville, j’aime les parcs. En forêt, la ville me manque.
Je voudrais être quelqu’un d’autre. Je trouve que les autres ne sont pas mieux que nous.
Je suis un solitaire qui aime le monde.
Je ne fais pas l’unanimité.
On m’aime. On ne m’aime pas.
Je suis plein de contrariétés.
Full.
Je suis un Mini-Wheat.
Sain. Malsain.
Moins funny qu’une Froot Loops. Moins plate qu’une Special K.
Capable d’être sérieux. Incapable de l’être.
Éclectique.
Tissé d’une fibre de blé. Enrobé de sucre.
Et fier de l’être.
Côté positif. Côté négatif.
Un amalgame de qualités et de défauts.
Ying et yang. Noir et blanc. Abbott and Costello.
Je me méfie des gens unidimensionnels. Aux idées arrêtées. Incapables d’incartades. Comblés dans leurs certitudes. Convaincus de leurs croyances. Rarement plurielles.
Je pense que nous sommes multidimensionnels. Des diamants aux facettes multiples. Capables de refléter des nuances différentes. Surtout aptes aux actions irrationnelles, aux idées nouvelles. Surtout plurielles.
Je suis un Mini-Wheat.
Billets que vous pourriez aimer
Le ton des mots
 J’ai écrit ce courriel avec l’aplomb d’un avocat.
J’ai écrit ce courriel avec l’aplomb d’un avocat.
J’ai relu chaque phrase, en prenant le temps de changer un mot précisant mal ma pensée, en choisissant un autre pour le remplacer pour m’assurer que l’idée générale de mon propos soit respectée et encore plus précise.
Je l’ai gardé dans ma boîte de brouillons quelques jours.
Une boîte à bouillon. Parfaite pour mariner des mots. Ça leur donne du goût et une consistance. Ça permet de donner de la saveur à un texte. Une pertinence. Ajoutez une pincée de virgules et le tour est joué.
J’ai ressorti le courriel pour une dernière lecture. J’en ai profité pour ajouter quelques smiley pour m’assurer que les endroits dans le texte où mon discours était plus léger seraient perçus comme tels. C’est comme ajouter du rire en canne dans un sitcom. Hey, c’est le temps de rire si tu ne le savais pas. On n’est jamais trop prudent quand on écrit un texte important. Quand on veut éviter toutes mauvaises interprétations.
Relire son texte. Cliquer sur envoyer. Pioup. Courriel en route. Attendre la réponse.
Qui ne vient pas.
Au bout de quelques jours, j’appelle la personne auquel le courriel était destiné.
– Allo, tu vas bien? T’as reçu mon mail?
– Oui. J’ai décidé d’attendre une couple de jours avant de te répondre. Le temps de le digérer. Pour ne pas écrire sous le coup de l’émotion…
– Heu… On parle du même courriel? Celui de lundi?
– Ouais. Je savais pas trop quoi en penser.
En penser quoi?
Coudonc.
Cette missive était claire comme de l’eau de roche. Des mots choisis un à un, avec parcimonie. J’ai jardiné dans Le Larousse. Des phrases construites avec la précision d’un chirurgien. Des blagues faciles à comprendre, avec des petites binettes (comme l’OQLF veut qu’on écrive emoticon), pour savoir que ce petit bout de texte est mis là pour adoucir le ton du discours. Dans un ton déjà hyper molo.
Selon moi.
Faut croire qu’il était uniquement sans ambiguïté pour moi. Pas pour son destinataire.
En cette ère numérique où jamais mots ne se seront autant échangés: par courriel, texto, tweet et statuts Facebook, combien de mauvaises compréhensions, imbroglios créés à coup de mauvaise sémantique, intonation, ponctuation, syntaxe?
Toute cette littératie. Le niveau de celui qui écrit, de celui qui reçoit. Tous ces mots aux différentes significations, écrits sur le coup de la colère, ou celui de l’humour. Tous ces degrés de lecture où l’ironie est perçue comme une insulte, ou un compliment exprimé comme une gifle.
Tous ces mots qui se changent en maux.
Tu m’énerves. Ça peut dire que tu me tombes sur les nerfs. Ça peut aussi dire que tu me plais. Tout dépend du contexte.
Vous envoyez un courriel que vous considérez anodin et vous déclenchez une guerre nucléaire. Boum. L’effet papillon multiplié par 1000. Un mot mal placé et vous changez le rythme d’un échange. Guerre et paix. Guère et pet. Et voilà. Vous êtes dans la merde.
Quand tu t’adresses à une seule personne, ça peut aller. Surtout si tu la connais, car tu peux adapter le niveau du texte à celui du lecteur. Quand tu t’adresses à une foule, comme on le fait en pub, vous imaginez le nombre d’interprétations auxquels votre slogan ou campagne peut avoir? C’est fou. Et déroutant.
Vous voulez savoir comment s’est terminée mon histoire?
La personne ne me parle plus. Fin. Plus de nouvelles. Rien. Malgré mes explications directes, mon point de vue exprimé au téléphone. Rien n’a changé. Son point de vue est demeuré le même. Intrinsèque. Mon courriel est resté logé dans sa gorge. Incapable de le digérer. Intolérance à ma grammaire. Lettre morte. Oraison funèbre. Fin.
Les paroles s’envolent et les écrits restent.
Imaginez quand ils sont, en plus, mal compris.
Ça devient des restes d’écrits qui s’envolent sans paroles.
Billets que vous pourriez aimer
Je ne t’aime pas, mais ne sais pas pourquoi.
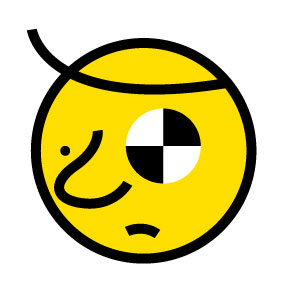 – Allo Marc, j’ai un projet à te proposer…
– Allo Marc, j’ai un projet à te proposer…
– Cool. C’est quoi?
– Vendre tel produit.
– Mmm, je ne suis pas certain être la bonne personne pour en parler… Honnêtement, je ne peux pas dire que j’aime ton produit…
– Justement. C’est ce dont j’ai besoin.
Je me suis dit pourquoi pas, hein? Pourquoi pas.
Vierge. Ou le contraire, full contaminé.
Par mes propres préjugés et ceux des autres. Surtout ceux des autres. Ce qui est encore pire, vous en conviendrez. Allez. Ne me dites pas que ça ne vous arrive jamais. Je ne vous crois pas. Je vous lis sur Facebook. À colporter des trucs sur lesquels vous vous fiez uniquement à l’opinion de vos amis pour prendre position. Si si. Allez. On est entre nous. Vous faites comme ça, vous aussi. Allons. Soyons honnêtes.
Baser ses idéaux sur des idées basses.
Même pas les nôtres.
J’ai accepté ce mandat parce que justement je n’aimais pas le produit que j’avais à vendre. En réalisant rapidement que je le connaissais, avant tout, très peu. Nuance majeure. Ça peut vous sembler louche, mais ça vient (trop) souvent ensemble. Cette peur de l’inconnu qui nous pousse rapidement de l’autre côté. Nos perceptions négatives renchéries par les influenceurs qui nous entourent. On n’aime pas parce que buddy, votre pote avec qui vous avez 103 amis en commun sur Facebook, celui qui a voté comme vous, avec qui vous partagez un avatar de couleur rouge, noir, ou blanc, mais vraiment surtout parce que votre buddy ne l’aime pas.
Bref. J’ai accepté le mandat en me disant que si je ne suis pas leur client type pour un paquet de raisons, plus ou moins logiques, plus ou moins bonnes, avec des perceptions que je partageais avec un paquet de gens qui ne sont pas leurs clients non plus, ben, ça pourrait les aider. Je suis comme ça.
Éthiquement? Ne venez pas me faire de chichi. Je suis en pub. I am annoying by definition. And I know it. And It’s my job to be. Vous mettre des trucs dans la tête. Vous faire aimer des produits. Même ceux que je n’aime pas moi même. Vous faire hésiter. Vous faire changer d’idée. Avec mes arguments. Ma force de persuasion. Ben oui. C’est mon métier. De vous faire tomber en amour. J’exagère à peine. Du moins, j’espère vous matcher. Une petite vite. Vous verrez après si ça va plus loin. Ça vous appartient. Au produit et à vous. Moi, je ne suis que l’entremetteur. Cupidon.
Quand j’y pense, mon client avait raison.
J’étais la meilleure personne pour me convaincre qu’un produit honni était parfait pour moi.
Est-ce absolument indispensable d’aimer le produit pour bien en parler? Non. Il faut le connaître par contre. En chassant toutes nos perceptions injustifiées.
Hey produit, je ne t’aime pas, même si je ne sais pas trop pourquoi. Et si je mettais mes préjugés de côté et qu’on repartait on scratch, toi et moi?
C’est ce que j’ai fait. Je suis devenu le crash test dummy du produit en question. Pour vous.
Goûter. Cracher. Regoûter. Nuancer. Regoûter. Trouver des qualités. En parler. Reconnaître les défauts. Les rendre moins évidents. Chercher les mots pour en parler. Trouver des arguments. Sans bullshiter. Réaliser que rien n’est tout blanc. Ni tout noir. Que j’avais raison! Que j’avais tort!
Est-ce que j’ai réussi? Les ventes le diront. Dans mon métier, on peut bien se trouver bon, mais c’est le son du tiroir-caisse qui nous dit si nous le sommes ou pas.
Je sais par contre un truc : ma vision du produit en question a carrément changé. Je suis moins campé dans mes positions, moins tranché dans mes opinions. J’ai réalisé que la force de mes préjugés était particulièrement tenace et que je parlais (un peu, pas mal, trop) à travers mon chapeau.
Maintenant, je n’aime pas plus le produit, mais je sais pourquoi.
Billets que vous pourriez aimer
Les mille et une vies
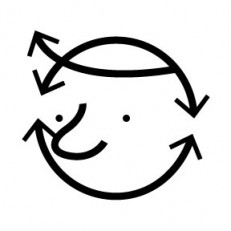
J’ai déjà acheté un banc de scie. Une scie sauteuse. Une scie circulaire. Une scie à onglets. Quatre ou cinq perceuses. Des équerres. Des serre-joints. Mille et un machins. Vis, clous, armatures et bois.
J’ai déjà été un vrai gars.
Comme mes chums.
Avec une remise et un établi.
Le samedi matin, j’allais chez Rona et chez Canadian Tire où je croisais des gars comme moi.
Dans une autre vie, j’étais un gars de maison. Avec tous ses outils accrochés fièrement au mur, le sac à clous à la ceinture, le crayon sur l’oreille.
Aujourd’hui, juste l’idée de visser une ampoule me lève le cœur.
Je déteste rénover.
Regarder la circulaire d’une quincaillerie me fait autant bander que tous les tomes de Fifty Shades Of Grey. En images.
Mes outils sont éparpillés un peu partout. Je n’ai souvent aucune idée à quoi servait un truc que j’ai acheté des années auparavant. Et je m’en fous.
Je ne suis plus là. Ma vie est ailleurs.
Je me suis déjà acheté un sac de golf. Des bâtons à l’unité sur eBay. Driver. Sand Wedge. Putter. Des quantités de sortes de balles. Pour corriger une déviation. Aller plus loin. Rouler plus longtemps. Nike. Taylor Made. Tiltest.
On jouait le samedi matin aux aurores. Toujours les mêmes quatre compères. On allait déjeuner vers 6h et jouer sur les terrains qu’on réussissait à réserver dans des villes différentes. Éric, Michel, Steve. Sous le soleil. Sous la pluie.
Puis, j’ai sauté une semaine.
Deux.
Un mois.
Un été.
En allant dans la remise, j’ai vu mon sac.
Un écureuil a bouffé la serviette accrochée à celui-ci. Mes bâtons sont demeurés couverts de boue. Celle de ma dernière partie jouée sous la pluie. Mon sac se balançait sur un clou comme un pendu. Effigie d’une vie antérieure.
Dans une autre vie, j’étais un golfeur. Un très mauvais.
Aller au golf, maintenant? Bof. Une fois par année, avec des chums pour une activité caritative. Un prétexte pour les voir à l’après-golf. Uniquement.
Quand j’ai commencé ma carrière en pub, j’étais de toutes les activités de réseautage d’affaires. Les soupers de Chambre de Commerce. Le serrage de mains. Échanges de cartes de visite. Promesses de rendez-vous. Contrats accordés par référence.
Avec mes pantalons à plis et mes chemises à rayures. Je n’y étais pas très à l’aise, mais fallait y être. Pour les affaires. Alors, le soldat en moi y allait.
Je n’y ai pas mis les pieds depuis des années.
Et je fais toujours des affaires. Même si je rencontre des gens tout en oubliant de leur donner des cartes.
Dans une autre vie, j’étais un homme d’affaires.
Plus maintenant.
Je suis toujours dans le même domaine, mais je suis différent. On m’engage parce qu’on aime bien ce que je fais. Mon style. Ma vision. Pas parce que j’ai payé un verre ou soupé dans une activité. Je travaille en short ou en jeans. En t-shirt. Souvent mal rasé. Les cheveux en bataille. En me faisant demander, chaque jour, si je suis en vacances.
J’ai déjà détesté l’hiver à m’en confesser.
J’ai déjà adoré l’hiver à lisser une patinoire à -35 tous les soirs pour amuser les enfants.
J’ai déjà redétesté l’hiver parce qu’il était simplement long à en plus finir.
J’ai quitté la région pour habiter la ville en crachant au sol, jurant ne jamais y revenir. Pour y revenir. J’ai détesté la campagne jusqu’à ce que j’y habite pour affirmer que je n’y retournerais jamais. Je ne voulais pas d’enfants, j’en ai deux merveilleux dont je ne voudrais jamais me séparer.
À l’aube de mes cinquante ans, j’ai l’impression d’avoir déjà vécu plein de vies différentes.
À aimer des trucs que je déteste aujourd’hui.
À détester des choses que j’adore aujourd’hui.
Des moments enivrants, difficiles, joyeux, affreux ou déroutants. Bien pépère, le cul dans un gros fauteuil confortable ou à la limite du vertige, la fesse sur une chaise bancale sur un fil de fer.
Tels des chats, nous avons cette faculté de revivre. De retomber sur nos pattes. Malgré des chutes dont on ne croyait jamais se remettre. Au lieu de s’écraser, à rebondir ailleurs. Plus loin. À avancer ou reculer. Nos vies ne sont pas linéaires ni chronologiques. On peut apprendre la mort tout jeune et commencer une carrière à l’âge de la retraite. Nos vies se succèdent. À grands coups de reniements. À grands coups de jamais et de toujours. Pour finalement prendre des directions insoupçonnées. À se remodeler selon les gens qui nous entourent, les passions qu’on découvre, avec la maturité qui nous rassure de plus en plus sur nos choix.
Je ne sais pas où je serai dans cinq, dix ou vingt ans.
Sûrement dans un autre cycle.
Ailleurs. Un peu plus près de moi.