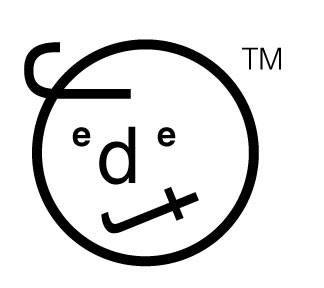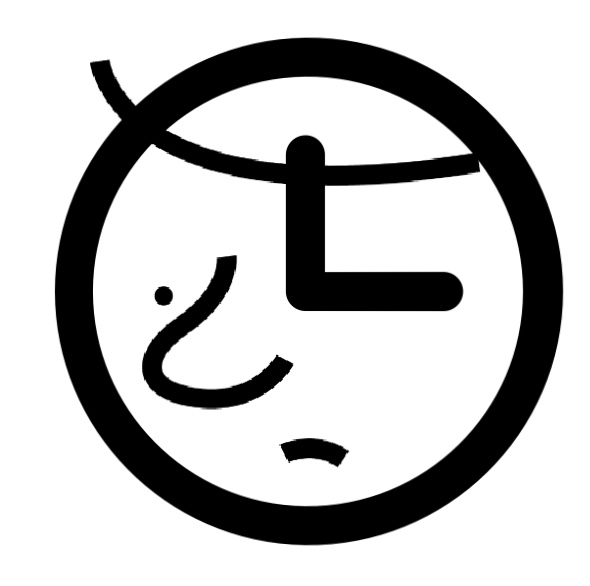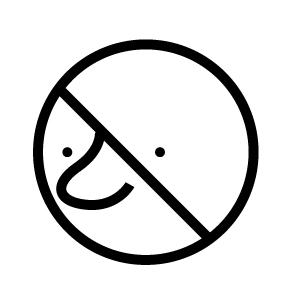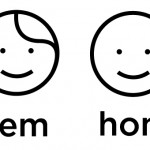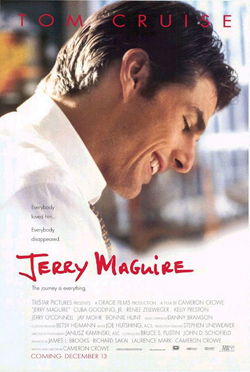Simili.
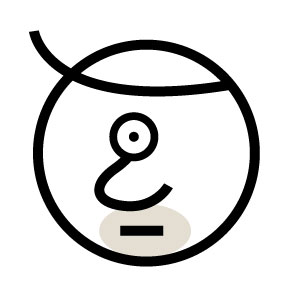 Quand j’étais jeune, les murs du sous-sol de la maison familiale étaient en préfini. Une simili planche de bois lignée, d’un huitième de pouce, fixée sur la charpente avec des clous pas de tête, des clous de finition. Dans les années soixante, le marché des maisons unifamiliales explosait. On construisait des bungalows préfabriqués un peu partout dans les banlieues et les régions. L’accès à la propriété était dorénavant accessible à une génération dont les parents n’avaient pas eu cette chance.
Quand j’étais jeune, les murs du sous-sol de la maison familiale étaient en préfini. Une simili planche de bois lignée, d’un huitième de pouce, fixée sur la charpente avec des clous pas de tête, des clous de finition. Dans les années soixante, le marché des maisons unifamiliales explosait. On construisait des bungalows préfabriqués un peu partout dans les banlieues et les régions. L’accès à la propriété était dorénavant accessible à une génération dont les parents n’avaient pas eu cette chance.
Pour arriver à fabriquer des maisons moins dispendieuses, on remplaçait les matériaux nobles comme la brique et le bois, par du clapboard et de l’aggloméré.
Pour imiter et remplacer les boiseries d’antan.
À moindres coûts.
Autour des mêmes années, on a eu droit à du simili jambon. Une pâte de viande grise industrielle auquel on ajoutait de la saveur et de la couleur. Pour faire semblant qu’on mangeait du vrai jambon. Ça se mariait à merveille avec la fausse moutarde fluorescente et le pain blanc tranché qui goutait le gâteau Duncan Hines en poudre.
Dans les années 80, on arborait le perfecto en simili cuir. On voulait se la jouer punk. No Future. Mais avec des Doc Martins qui nous coûtaient la peau du cul. Un walkman qui nous coûtait un bras. Des disques, des spectacles et de la drogue qui mangeaient nos économies. No future. Mais pas un no future de pauvre. Un simili no-future. Des punks de bonne famille. Avec l’aide financière de papa et maman. Et du gouvernement.
Les années 90 ont eu leur part de simili machins aussi.
Comme les années qui les ont suivies.
Au tournant des années 2000, je jouais au golf avec des copains. Il y en avait un qui «oubliait» souvent certains coups. Candidement, quand nous écrivions, sur la carte de pointage, nos scores astronomiques de mauvais golfeurs et que nous perdions la partie au profit d’un menteur, je me disais toujours la même chose : comment peut-il vivre avec l’idée de gagner comme ça.
On savait tous qu’il ne gagnait pas.
Il le savait aussi.
Que tout le monde pense que tu es hot, c’est une chose.
Que toi, tu saches que tu es un loser, il me semble que ça fesse.
Simili gagnant.
Aujourd’hui, avec l’avènement des réseaux sociaux, on est au summum du toc.
Les faux millionnaires.
Les faux bons gars.
Les fausses amies.
Et toute cette pléthore de conférenciers et coachs de vie.
Simili professionnels.
Qui nous donnent de simili conseils à partir de leur simili succès.
Tout ce faux bonheur exposé.
Simili joie.
Les instagrammeurs et leurs photos parfaites.
Retouchées.
Sponsorisées.
Simili perfection.
On berne qui?
Avant tout soi-même.
Et c’est ce qui rend l’aventure encore plus pathétique.
Qu’on veuille être quelqu’un d’autre.
Qu’on veut ne pas être qui on est.
Qu’on veuille que les gens pensent autre chose de nous que ce que nous sommes vraiment.
Simili auto appréciation.
Je ne m’aime pas.
Mais je veux que vous m’aimiez.
Même si c’est un faux amour.
Basé sur une fausse présentation.
Une simili foi.
Un simili soi.
Un simili moi.
Billets que vous pourriez aimer
La fin d’une aventure.
 La fin d’un projet, ça se passe souvent comme la fin d’une aventure amoureuse.
La fin d’un projet, ça se passe souvent comme la fin d’une aventure amoureuse.
Pas comme dans la vraie vie, là.
Plutôt comme dans les films d’ado.
Comme dans la chanson Hélène de Rock Voisine.
Tu es consultant, tu débarques passer l’été à Old Orchard et tu rencontres ce super projet sur la plage.
Tu tombes en amour.
Je veux passer ma vie avec toi.
Et à la fin de l’été, comme tu dois repartir, ton amour impossible te revient en pleine face.
Seul sur la plage, les yeux dans l’eau.
Mon rêve était trop beau.
Cette semaine, j’ai appris que le magazine CVS dont j’assumais la direction artistique et la conception depuis sa création, ne sera dorénavant plus publié.
Vous dire que je ne m’y attendais pas serait vous mentir. En fait, je m’y attendais depuis le numéro deux.
Bon, peut-être pas le deux, j’exagère un peu, mais je m’y attendais chaque année.
Parce que la vie d’un magazine est rarement longue.
Parce que je sais que ce genre de projet représente une somme colossale de travail, surtout pour la mini équipe que nous formions, dont personne n’était à temps plein sur le projet.
Parce que l’exigence des horaires de ce projet mettait en péril certains dossiers que j’avais avec d’autres clients ou me privait de participer à d’autres mandats.
Même si ma vie professionnelle a toujours été bâtie sur de longues relations d’affaires – j’ai des clients qui me suivent depuis plus de 20 ans – je sais que nous sommes toujours à rebâtir une relation B2B.
La vie de consultant externe est toujours de vivre sur la corde raide.
Ce n’est pas la première fois qu’un projet se termine ou qu’un client part. Et ça ne sera pas la dernière fois.
Mon domaine d’affaires est comme ça.
La vie aussi, remarquez.
Bref, la fin du CVS marque une étape dans Traitdemarc qui fêtera ses 10 ans, en février. Parce que ce projet aura duré 9 ans, il est indissociable de ma petite histoire.
Ce n’est pas rien.
Je suis triste de terminer un si beau projet, c’est certain.
Ne pas l’être serait de minimiser le plaisir de le réaliser et de travailler avec une équipe extraordinaire. De rencontrer des entrepreneurs allumés, des commerçants travaillants, de sentir qu’on a réussi à faire connaître ceux-ci dans une publication hors-norme, créative et d’une qualité irréprochable.
J’ai des souvenirs plein la tête de moments complètement magiques et de créations rocambolesques.
Je me souviendrai longtemps de toutes ces publicités où de simples commerçants jouaient au mannequin pour la première fois de leur vie dans des concepts complètement flyés.
Je m’en voudrais de ne pas remercier mon ami Paul Cimon, mon vieux pote photographe des 25 dernières années. Notre duo a tenu la route malgré les délais serrés, les prises de bec et les bouchons de productions. Au final, le résultat était toujours positif et créatif.
Je m’en voudrais aussi de ne pas remercier toute l’équipe de Promotion Saguenay pour leur grande confiance dans ce dossier.
On a tendance, à tort, de toujours remercier un client quand on obtient un mandat. C’est à la fin de celui-ci qu’on devrait le remercier.
Parce qu’une relation d’affaires ne se matérialise pas dans un seul mandat. Que la vie est longue et que la fin d’une aventure marque toujours le début d’une autre.
Je voudrais aussi remercier tous les clients qui ont paru dans le magazine. J’ai toujours été un gars de centre-ville, j’y suis même né. Leurs commerces, souvent menés à bout de bras, sont toujours le fruit d’une passion, d’un savoir-faire et d’un travail acharné. J’ai rarement vu travailler du monde autant que ça. Dans des conditions économiques pas toujours faciles.
Je leur lève mon chapeau. Vous êtes notre fibre économique.
Pour la plupart, je ne vous aurai plus comme client, mais vous pourrez toujours compter sur moi, comme client.
L’été qui s’achève tu partiras
À cent mille lieues de moi
Comment oublier ton sourire
Et tellement de souvenirs.
Billets que vous pourriez aimer
Mon histoire.
 Mon histoire contient plusieurs chapitres, certains palpitants et d’autres sur lesquels on s’endort.
Mon histoire contient plusieurs chapitres, certains palpitants et d’autres sur lesquels on s’endort.
Mon histoire est un roman-fleuve et ce n’est pas l’amer à boire.
Mon histoire est à suivre, même si je ne connais pas la suite.
Mon histoire n’a aucun sens sans la tienne.
Mon histoire ne passera jamais à l’histoire.
Mon histoire est un livre d’images. Parfois multicolores. Parfois noir et blanc.
Mon histoire est une page blanche et des mots noirs.
Mon histoire est d’une durée limitée.
Mon histoire est tripante pour certains, flippante pour d’autres.
Mon histoire s’écrit à l’imparfait.
Mon histoire est unique.
Mon histoire est celle de Pierre, Jean, Jacques.
Mon histoire est pleine de maux.
Mon histoire est écrite au présent, pour oublier le passé et, surtout, pour ne pas anticiper le futur.
Mon histoire est à subir.
Mon histoire n’est pas toujours racontable.
Mon histoire s’écrit à la main, sur un iPhone, sur un ordinateur, mais ne vivra jamais sur un écran.
Mon histoire est remplie de clichés que je prends ici et là.
Mon histoire est construite de conjonctions, mais
tout autant de contradictions.
Mon histoire n’est peut-être pas celle que vous aimeriez entendre.
Mon histoire est celle d’un gars ordinaire.
Mon histoire est à prendre à la légère, même si je pèse mes mots.
Mon histoire a des humeurs quand il est question de rumeurs.
Mon histoire est pleine de ratures, toujours à la recherche d’un meilleur terme. L’ultime.
Mon histoire est remplie de fautes dont certaines que j’assume.
Mon histoire est un casse-tête dont il manque des pièces.
Mon histoire est un jardin de proses, même si parfois, elle ne rime à rien.
Mon histoire est d’une simplicité complexe.
Mon histoire commence parfois par la fin d’une autre.
Mon histoire est comme celle d’un milliard de personnes qui pensent qu’ils sont uniques.
Mon histoire. Sujet. Verbe. Complément.
Mon histoire est un récit de voyage dont je ne connais pas la destination.
Mon histoire est composée en Helvetica et imprimée sur du papier vélin.
Mon histoire est un bulletin météo avec des orages effrayants, des tempêtes à se perdre, mais tout autant de rayons de soleil qui rendent aveugle.
Mon histoire est celle d’un citoyen du monde sédentaire.
Mon histoire peut être totalement soluble avec celle de certaines personnes, insoluble avec d’autres.
Mon histoire est épicée, parfois salée, rarement sans saveur.
Mon histoire a un début et aura une fin, entre les deux ça se complique.
Mon histoire est parfois familiale, parfois amicale, parfois sociale, souvent individuelle.
Mon histoire pourrait être celle d’un autre, mais je ne vivrais pas celle d’un autre.
Mon histoire change au contact des autres.
Mon histoire est une série télé: j’ai souvent hâte à la prochaine saison et quand je la visionne je suis déçu.
Billets que vous pourriez aimer
Chroniques sri lankaises
C’est pas parce que j’écris moins ici que je n’écris pas.
Voici en vrac, les clins d’oeil envoyés sur Facebook pendant mon séjour au Sri Lanka.
Les lieux n’ont peu ou pas de rapport avec le texte, sinon d’indiquer où ceux-ci ont été écrits.
 Colombo
Colombo
J’ai marché sur Galle Road sous la bruine. J’ai seulement croisé quelques passants sur ce grand boulevard qui traverse la ville de Colombo. Un contraste avec ma randonnée de l’après-midi dans le vieux quartier de Pettah. Quartier marchand où chaque pouce est convoité. Des ces rues étroites, camions de livraison, scooters, tuk-tuk, transporteurs de chariot et piétons se partagent le peu de place que les commerçants leur laissent. C’est un véritable Tetris. Ça crie, ça klaxonne, ça se bouscule. C’est un capharnaüm. Ajoutez les odeurs, la promiscuité des gens et ça vous donne un portait plus juste. À ma première journée au Sri Lanka, j’apprivoise une nouvelle culture. De nouveaux codes. Certains que je connaissais, d’autres moins. Au resto où j’ai mangé ce midi, j’étais le seul caucasien. Un charmant monsieur m’a aidé à passer ma commande. Il a même pensé demander une fourchette. Les gens me semblent gentils, j’ai eu droit à quelques questions classiques (where u from? – ho itz cold), mais je ne suis pas sous le charme de Columbo. Elle est, comme la décrivent la plupart des guides que j’ai lus, une ville polluée avec de multiples chantiers de construction, avec quelques monuments coloniaux intéressants, mais sans plus.
 Habarana
Habarana
Lever du corps, 4h30.
La tête, elle, ne dort jamais.
Direction, station de train Fort.
Comme la tentative de la veille de me procurer un billet réservé assis en classe 2 avait été nulle, je me suis rabattu sur un qui me donnait le droit d’entrer dans le train sans savoir si je ferais le trajet de 6h assis ou debout.
Un gros 300 roupies. 2,40$. Au yable la dépense, je suis en vacances.
Billet en main, je me retrouve sur les quais sans savoir lequel va où. Pardon, Habarana, c’est où? 4, me dit la petite dame. Merci petite dame. Assis sur mon sac, je redemande à une autre petite dame. Habarana, c’est bien ici? Yes yes yes. Là, j’ai eu une crainte. Car le yes yes yes, en voyage, est la pire réponse à recevoir. Ça peut vouloir dire : je te dis n’importe quoi pour que tu cesses de me parler où j’ai rien compris et pour pas passer pour malpolie, je te pousse n’importe quoi. Ce qui, on en convient, arrive à la même conclusion : t’es dans la chnoutte. Finalement toutes ces gentilles dames avaient raison. C’était de vrais yes, yes, yes.
Donc, première expérience de train sri lankais.
Vieille locomotive. Vieux wagons. Vieux passager. Oui, oui. Je sais. Ça brasse comme dans une vieille machine à laver. Un vacarme sur les rames, fer sur fer, et l’on roule au max 40 km. Ce qui explique que la distance Colombo-Habarana, 241 km, se fait en six heures et des poussières. Heures qui ont passé super vite. Les multiples arrêts dans toutes sortes de Sorel sri lankais. Le décor extérieur. La vie intérieure agrémentée par les marchands ambulants, quêteux sans bras/jambe/voix, les enfants-gripettes et les passagers heureux de te baragouiner les quelques mots anglais qu’ils connaissent.
Ouere are zou from?
Canada.
Iz it cold?
Yes yes yes.
 Kandy
Kandy
Dimanche.
Jour férié au Sri Lanka.
Ici, à Kandy, c’est encore plus visible, car c’est le fief du bouddhisme et y’a du monde qui débarque à la tonne pendant les congés. Vêtus de leurs plus beaux habits blancs, ils convergent vers le Temple de la dent. Oui, oui de la dent, de Bouddha. Bon, je ne suis pas allé vérifier, mon quota de temples étant atteint, alors j’ai décidé de les croire sur parole si la dent est bien là. On a bien le cœur du frère André.
Alors.
C’était donc congé pour moi aussi.
Aucune visite à l’agenda. Jour de lavage. Ça fait du bien. Et promenade dans Kandy. Que j’ai bien aimé finalement. Malgré les critiques négatives des guides, j’ai trouvé la ville charmante et les gens super sympas. Comme c’est une ville très croyante, oubliez les partys jusqu’aux petites heures, il faut chercher fort pour trouver de la bière, mais y’a un pub anglais qui est parfait pour ça.
J’écris de là présentement.
À la sortie du marché où j’avais acheté des épices, le jeune Anouah qui a alors décidé de me faire un brin de jasette en m’accompagnant pendant mon tour du lac, m’a dit : hey beau chapeau (en anglais) et j’ai répondu istouti qui veut dire merci.
J’ai appris ça.
Et surtout néhé istouti. Non merci.
Car ici, faut l’utiliser à chaque pas. Non, merci pas de tuk-tuk, pas d’orange, pas de briquet, pas de montres, jusqu’à l’infini.
Et je n’ai pas de problème avec ça.
C’est mon devoir de touriste de me faire solliciter. Faut pas me rentrer dans les culottes et quand j’ai dit non faut pas me suivre jusque dans l’avion, mais c’est normal de se faire vendre de quoi. On est une business. Comme touristes. Et on a du cash. Beaucoup de cash.
Alors assumons notre richesse.
Même chose pour les achats dans les marchés: c’est ok de payer plus cher. Ça fait partie de la game. J’accepte l’arnaque. Pas le vol. Mais de me faire payer plus cher un truc, j’endosse ça. Surtout que la plupart du temps, on parle de peu d’argent. Et de beaucoup pour eux. L’an dernier, en Indonésie, j’avais partagé un taxi avec un couple de français et j’avais eu honte quand la femme avait piqué une crise pour moins d’un dollar. Devant ma face stupéfaite, elle m’avait répondu que, pour elle, c’était une question de principe. Principe de quoi? Je gagne en une heure ce que ce gars gagne en une semaine, peut-être par mois. Principe de merde, oui.
Donc, Anouah m’a accompagné pendant plus d’une heure autour du lac. Tu cherches de quoi? Non. Tu veux aller voir un spectacle. Non. Tu veux que je te montre le meilleur point de vue. Non. Mais aussi des questions sur nos pays respectifs. Au bout d’une heure, comme je n’étais pas un bon client, devant la pâtisserie, il m’a demandé où je m’en allais et lui ai dit à mon hôtel. Il m’a demandé : tu as quelque chose pour moi? Je lui ai sorti une poignée de change et il a filé s’acheter un pain.
Merci mon ami, qu’il m’a dit.
Y a pas de quoi.
L’amitié, ça n’a pas de prix.
Ou sinon si peu.
 Dalhousie
Dalhousie
Adam’s Peak. Montagne située à Dalhousie, au Sri Lanka.
Au sommet de la montagne, on trouve une cavité de presque deux mètres qui fait penser à une empreinte de pas. Les hindous y voient la trace du passage de Vishnu. Pour les musulmans et les catholiques, il s’agit de l’empreinte que fit le pied d’Adam. Pour les bouddhistes il s’agit de l’empreinte de pied de Bouddha. Pour les autres, comme moi, c’est pour la déesse Endorphine qu’il faut gravir le monstre.
Pour une fois que tout le monde y trouve son compte, laissons ça comme ça.
Donc, le pic d’Adam est escaladé chaque jour par des pèlerins et des touristes du monde entier.
17km aller/retour. 4500 marches. 2243 mètres d’altitude. 1000m de dénivelé. Idéalement, comme moi, vous vous levez à 2h30 et vous partez à 3h du mat’ pour apercevoir le soleil se lever, à votre arrivée, autour de 6h.
Tu pars avec deux couches de vêtements, tu enlèves tout ce que tu peux pendant l’ascension puis tu remets les deux couches, plus un duvet, parce qu’en haut, c’est frette rare.
T’as beau être pas pire en forme: des marches, ça tue.
L’acide lactique. Le cardio géré différemment. Tu te concentres sur la prochaine marche et là, tout à coup, sans raison, ta jambe est lourde.
Pendant l’ascension, j’ai entendu toutes les langues inimaginables. Des vieux. Des jeunes. Habillés full technique avec les meilleurs vêtements respirants ou bedon tout croches avec les babouches qui dérapent.
Toutes sortes de monde.
Et puis Dilshan, le moineau, ou petit moine bouddhiste, qui lui, l’a fait pieds nus du haut de ces 10 ans.
Ça valait une photo.
 Nuwara Elya
Nuwara Elya
Hier, train de Nuwara Elya à Ella.
Train public. Train du peuple.
Le train bleu pour l’express.
Le rouge pour les autres.
À peu près le même confort si tu es assis.
Même circuit sauf que le rouge arrête partout.
Partout.
Ce qui fait que si tu prends le bleu de 13h30 pour Ella, t’arriveras autour de 16h.
Si, comme moi, tu prends le rouge à 9h30, tu vas arriver à 14h.
Dans un train bondé comme une canne de sardines.
Fou.
J’étais dans le corridor près des portes.
Debout.
Pris entre tous les sacs à dos et les passagers.
Entre les deux portes, j’ai compté 14 personnes.
Plus des sacs à dos, des valises et des boites.
Espace vital : tes deux pieds.
Chaque mouvement provoque quelque chose.
Un sac empilé qui tombe.
Un coude dans le dos.
Si tu es du genre claustrophobe.
Ce n’est pas trop ta place.
Mais cette promiscuité provoque des échanges.
Tu rencontres d’autres voyageurs.
Des jeunes. Beaucoup de jeunes.
Pas mal le plus vieux dans le corridor.
Et comme c’est un train public, beaucoup de Sri lankais.
Empilés comme nous.
Pas de différence.
Ça fait mon affaire.
Je n’aime pas l’idée de me trouver assis privilégié dans un wagon alors que dans un autre s’empilent 200 personnes.
Je ne vis pas bien avec ça.
Alors dans notre petit corridor, tout ce beau monde a fait du mieux qu’il pouvait pour que chacun trouve son compte.
Tasser un sac.
Descendre un enfant du train pour le donner à sa mère.
Se passer un sac d’arachides.
De biscuits.
Rire surtout.
Parce que c’est drôle de se trouver comme ça.
C’est un voyage dans le voyage.
5 heures de randonnée.
60 cents.
Tu ne trouveras pas meilleur deal.
Pour voir le monde.
 Ella
Ella
On peut difficilement parler du Sri Lanka sans mentionner le thé. Il est omniprésent dans les montagnes, autour de Nuwara Eliya, Haputale et Ella. Plus de 700 Tea Factory sur l’île. Des champs dispersés partout dans le centre montagneux de l’île.
Le Sri Lanka se classe quatrième dans la production mondiale après la Chine, l’Inde et le Kenya. Ce qui est exceptionnel quand on pense à la grandeur du pays.
Le thé du Ceylan est reconnu comme un des meilleurs. Thé noir décliné en plusieurs catégories.
On ne peut parler de thé sans mentionner les cueilleuses. Et il faut utiliser le féminin, car ici, ce sont uniquement des femmes qui en font la cueillette. Majoritairement tamoules. C’est un travail délicat et exigeant, surtout épuisant. On doit choisir les meilleures feuilles sur la pointe, tout en tentant de le faire le plus rapidement possible. Par la suite, placer les feuilles dans le sac qu’elles supportent avec leur front. C’est impressionnant de les voir travailler. Impressionnant et aussi difficile. Surtout quand tu imagines leurs vies.
C’est pourtant avec sourire que j’ai pu en photographier quelques-unes. Toujours avec permission.
Travailleuses acharnées, elles en cueillent près d’une vingtaine de kilos par jour. Du matin au soir. Tout ça pour moins de 5$ par jour. Comme pour le café ou le riz, vous vous imaginez bien que ce n’est pas eux qui reçoivent la plus grande part du butin lorsqu’on achète un sachet chez David’s Tea.
Thé amer.
Appréciez chaque gorgée.
Vous le devez à ces femmes.
 Uda Walave
Uda Walave
Paqueter.
Dépaqueter.
Rouler.
Plier.
Froisser.
Serrer.
Zipper.
Dézipper.
Ouvrir.
Fermer.
Empiler.
Gérer.
Assembler.
Laver.
Étendre.
Sécher.
Ranger.
Transporter.
Tirer.
Forcer.
Porter.
Faire.
Défaire.
Refaire.
Voyager.
Infinitif présent.
Galle
J’ai tout perdu dans le tsunami de 2004. Ma femme, mes enfants et ma maison. J’en suis sorti vivant, mais ma cheville est brisée.
J’ai regardé sa cheville. Ça ressemblait plus à un genou. Mais avec un pied au bout.
Tu peux me donner de quoi?
J’ai croisé un autre vieillard.
Un sari seulement, noué autour de sa taille. Pieds nus. Peau de cuir.
Tu me paies un carton de lait?
En bas de l’épicerie où je suis arrêté acheter de l’eau, y’avait cette vieille dame dans les marches. La peau multicolore. Vitiligo. Dépigmentation de la peau. Sa main cherchait l’aumône.
Elle ne m’a rien dit.
Et puis y’a eu cette femme et ses enfants. Le regard lourd, près du terminus.
Cet unijambiste. Assis à côté de moi dans le bus.
Le gars couché sur le trottoir.
L’autre madame.
L’autre enfant.
Celui-là. Celle-là.
En voyage, la misère est omniprésente.
Elle fait partie du décor.
Elle n’est pas attraction. Personne ne souhaite voir ça.
Personne.
Surtout pas nous.
Mais elle est là.
Dans ta face.
Sur ta peau.
Dans ton nez.
Parce que la misère, ça pue.
Ça rentre dans tes narines et ça te bouffe le cœur.
Malgré les kilomètres. Les pays visités. Tu ne t’y habitues pas.
Y a un clash qui se fait quelque part. Un malaise.
Tu essaies de faire la part des choses. Te dire que tout ce que ces gens racontent sont des bobards. De la bullshit à touristes.
Y’en a sûrement.
Tout se vend. Se monnaye.
La misère aussi.
Mais tu ne veux pas penser ça.
Parce que si c’est vrai et qu’en plus tu ajoutes l’injure de ne pas y croire, ça fait de toi un moins que rien.
Tu passes ton chemin.
Tu ravales ton malaise.
En te disant que tu ne peux pas sauver le Monde.
Que tu peux donner ici et là, certes, mais que ce sera peut-être plus à toi que tu feras du bien.
À ta conscience.
Que la misère ne disparaîtra pas en donnant 1$, 5$ ou 10$.
Non.
Elle sera toujours là.
Sur celui-là. Sur celle-là.
Ou un autre.
Dont tu ne prendras surtout pas la photo.
 Negombo
Negombo
Hey toi, mon Sri Lanka, tu m’as bien eu.
Pour être honnête avec toi, tu n’étais pas mon premier choix. Si le Myanmar ne s’était pas conduit comme un barbare envers les Rohingyas, je serais en train de parcourir ce pays. Je ne pouvais pas une minute endosser un pays délinquant par ma présence.
Donc, voilà. J’ai cherché une alternative.
J’ai regardé des photos, lu des livres et quelques blogues afin de m’inspirer.
Et tu sais quoi?
Je n’avais toujours pas envie d’aller te voir.
Ça peut paraître bizarre d’entendre ça, mais j’ai rarement une envie folle de me rendre à un endroit.
Pourtant, sur place, je ne voudrais plus revenir.
Bon. Voilà. J’ai décidé d’aller chez toi.
Sur ton île.
À reculons.
Je suis arrivé à Colombo et cette ville m’a donné toutes les raisons de penser que je m’étais vraiment trompé de destination.
Je n’ai pas aimé ta capitale.
Trop de pollution. Trop de klaxons. Pas assez de sourires.
Notre premier rendez-vous n’était pas génial, avoue.
Tu ne voulais pas de moi?
Alors j’ai pris le train et tu as commencé à te montrer un peu plus séduisant.
Les gens me saluaient. Me posaient des questions. Les enfants faisaient des coucous. Et j’ai commencé à manger ce que tes vendeurs dans le train apportaient avec eux.
On m’a souvent par le ventre.
J’ai commencé à goûter le pays.
C’est bon ce que tu fais.
Tes currys différents d’une place à l’autre.
Ton kottu roti qu’on appelle ici le repas des pauvres. Je vais te dire que si ça, c’est de la bouffe de pauvres, je veux bien t’échanger quelques repas de riches de chez nous. Tes samossas qu’on ramasse un peu partout sur la route; toujours une surprise à chaque bouchée, à se demander de quoi il est fourré. La plupart du temps épicé. Très. Et savoureux.
Tu sais quoi? 8O% de ce que j’ai mangé chez toi était végétarien. 20% de poisson. Ça m’a fait réfléchir sur ce que je mange chez moi.
Je me pensais ouvert, je le suis encore plus.
Et puis, j’ai vu tes montagnes.
Ç’a été mon grand coup de cœur.
Elles étaient magnifiques tes montagnes. Et les gens qui y travaillent aussi.
En fait. Je vais te dire. J’ai adoré toutes les places où vous étiez là, les Sri Lankais. Pas que je n’aime pas les touristes. J’en suis un, buddy, mais je préfère les villes ou villages équilibrés. Quand vous n’êtes pas dans un ghetto. Et que nous ne le sommes pas aussi par le fait même. Moi, j’aime que l’on soit parmi vous. Parce que vous êtes chez vous. Nous, on visite. Et c’est particulièrement ce que je viens chercher chez toi, cette différence. Alors, ne me sers pas de bouffe européenne ou américaine. La tienne est parfaite.
Quand je me retrouve dans un bar où il y a seulement des étrangers, je n’ai pas l’impression d’être chez vous. Tu comprends?
C’est pour ça que tu es surpris quand tu me vois débarquer dans un bouiboui pas habitué de voir des touristes. C’est là que je me sens le mieux. À manger comme vous. À vous regarder commander et manger.
Dans votre quotidien.
Je quitte le mien pour vivre le tien?
Ouais.
Ça peut paraître de l’extérieur comme ça. Mais pas de l’intérieur.
J’ai cette soif de voir le monde.
Et plus je bois à la source, plus j’ai soif.
Tu vas me laisser un beau souvenir, Sri Lanka.
Les belles histoires d’amour ne partent pas toujours d’un coup de foudre.
Tu en es la preuve.
Billets que vous pourriez aimer
Sophie.
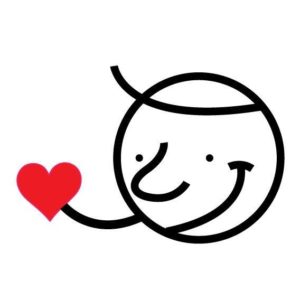 « Marc, il est super fin, mais faudrait pas qu’il s’imagine que je m’intéresse à lui, tsé… »
« Marc, il est super fin, mais faudrait pas qu’il s’imagine que je m’intéresse à lui, tsé… »
C’est à peu près comme ça que Marie-Claude, ma chum, m’a rapporté ce qu’elle avait entendu au café étudiant, ce matin même.
J’ai 17 ans. Au cégep. Depuis trois jours, j’ai passé tout mon temps au café étudiant, à la cafétéria, dehors ou dans les bars du centre-ville. Partout. Sauf dans mes cours. Partout, surtout, où Sophie est présente.
J’ai 17 ans et le cœur veut me sortir de la poitrine quand je la vois.
Petite. Incisive. La coupe au carré. Sophie parle de littérature, de musique, de politique, de n’importe quoi avec une assurance qui me fascine. Je suis un petit cul à côté d’elle. Elle a quelques mois de plus vieux que moi, mais j’ai l’impression qu’une décennie nous sépare.
Je veux être partout où elle va.
Mais elle s’en fout.
Allo, tu viens souvent ici, toi aussi. C’est cool comme place, non?
Non. Jamais. Je déteste cette place.
Je ne dis jamais ce qu’il faut.
Je force la note.
Elle est dans sa bulle.
Et moi je fabule.
À m’imaginer que je pourrais lui plaire.
Moi, le ti-cul du bas de la ville.
Elle, la chick du haut de la ville.
Faudrait pas que je m’imagine que je l’intéresse.
Tsé.
C’était y a plus de trente ans.
Un vendredi, sortant de chez un client en direction de ma voiture, j’ai recroisé Sophie. Assise sur un banc public. Tout juste devant mon véhicule. Je suis resté surpris. Je ne l’avais pas revu depuis une vingtaine d’années.
Je l’ai regardé.
Elle n’avait pas changé.
La coupe au carré.
Je lui ai souri.
Sans retour.
Le regard ailleurs que sur moi.
Elle n’avait vraiment pas changé.
Désintéressée.
J’ai continué mon chemin.
Comme y a trente ans.
Hier, en prenant la rue du Havre, pour rejoindre mon bureau, je suis passé devant la Soupe populaire. Comme toutes les fois, j’ai ralenti, car la rue est exiguë et plusieurs personnes sont à l’extérieur pour fumer ou jaser devant la porte de l’établissement.
Généralement des gars.
Depuis le temps que je fais ce trajet, j’en reconnais quelques-uns : ce grand barbu avec une tête plus petite que son long corps, le petit vieux qui ressemble au Père Noël ou cet autre marcheur qui déambule sur la Racine à vider les cendriers publics. Du monde plus ou moins amoché. Maladie mentale. Dépendance quelconque. Des victimes d’une vie pas facile.
Cette fois, les gars étaient en demi-cercle.
Au milieu y’avait une fille.
Assise sur le trottoir.
La coupe au carré.
Sophie.
Toujours le regard ailleurs que sur moi.
Comme y a trente ans.
Pourtant, moi, je n’ai jamais autant pensé à elle depuis.
À m’imaginer sa vie.
À m’interroger sur la mienne.
À tenter de comprendre comment celles-ci ont pu se croiser sans interagir.
D’hier à aujourd’hui.
Billets que vous pourriez aimer
411 840 secondes.
C’est le temps qui s’est écoulé entre deux courses.
La dernière de l’an passé et la première de cette année.
Long. Très long. Trop long.
Deux mois de mai différents.
Une fin. Un début.
Entre les deux, des visites chez des chiros, physios, ostéos.
Mais surtout un arrêt complet de course.
Bon, vous me direz qu’il y a pire dans la vie.
Et vous aurez raison.
Et tort.
Parce que vous n’êtes pas dans mes souliers. Encore moins dans ma tête.
Parce que dans mon cas, tout est connecté. Je suis de la tête au pied. Des pieds à la tête.
Les derniers mois ont donc été durs entre les deux.
J’avais le moral dans les talons.
Je crois à l’esprit sain dans un corps sain.
Ma tête prend son pied quand je suis sur la route.
La course me drille la tête et la fait respirer. Transpirer. Inspirer.
Je suis accro aux endorphines. Drogue dure. Euphorique. Gratos.
Donc, je suis de retour dans mes runnings.
Lent comme une tortue.
La bedaine qui me sort des shorts.
Je pompe l’huile.
Vieille F1 qui a abusé de la bière et du vin pendant son arrêt aux puits.
Je suis de retour avec un cardio de merde.
De minimes distances.
Une douleur latente.
Mais ma tête est heureuse.
Et, c’est ce qui compte.
Tout part de là. Le bonheur est là. Quelque part entre ses deux oreilles. Pas ailleurs.
Il est dans ma tête. Dans la tienne, aussi. Oui. Oui.
On peut greffer un paquet d’organes vitaux. Reconstruire des os broyés. Reconnecter les tuyaux.
Pour la tête, c’est différent.
Complexe.
Fragile.
Je suis de retour.
J’arpente à nouveau mes chemins de traverse.
J’anticipe les côtes.
Mon pied droit tire.
Le mollet se détend pour l’aider.
Je relève le bassin.
Lève le menton.
Tout le monde s’y met.
Travail d’équipe.
Je cours grand.
Mon sourire remplace ma bouche crispée.
La douleur s’évanouit.
Je pompe.
Pompe.
Le coeur s’emballe.
Je suis de retour.
Je cours malgré la douleur.
Parce que la douleur de la tête peut être plus grande.
Insupportable.
Je suis de retour.
Ça recommence à jaser dans le placard.
Les espadrilles font la fête.
On s’enlace.
Les odeurs d’effort émanent du panier à linge.
Ça sent le bonheur.
Ben oui, je sais.
Tout ça, c’est dans ma tête.
On prend son pied comme on peut.
Billets que vous pourriez aimer
Cabine coquine.
 Quand je voyage, les derniers jours sont souvent consacrés au magasinage. Un, comme je voyage assez léger, je ne veux pas m’embarrasser de poids supplémentaire, deux, j’ai d’autres choses à faire et trois, je me retrouve souvent dans une plus grande ville, pour prendre l’avion, ce qui facilite la chose.
Quand je voyage, les derniers jours sont souvent consacrés au magasinage. Un, comme je voyage assez léger, je ne veux pas m’embarrasser de poids supplémentaire, deux, j’ai d’autres choses à faire et trois, je me retrouve souvent dans une plus grande ville, pour prendre l’avion, ce qui facilite la chose.
Ce que je ramène? De la bouffe et des vêtements. Mais pas seulement pour moi.
Y’a pas un voyage d’où je ne ramène pas des chandails pour ma mère. En fait, ça m’est arrivé une seule fois : j’étais en pleine brousse africaine en mission humanitaire. J’avais une bonne raison.
Donc, ma mère possède, dans sa garde-robe, des chandails de tous les pays que j’ai visités. Attention, on parle pas ici d’un vulgaire t-shirt écrit «Hanoï» ou «Amsterdam», on parle d’une création originale ou d’une ligne de vêtements venant du pays visité. Sinon qui provient d’une grande chaîne anglaise comme Mark and Spencer.
Si vous pensez qu’escalader un volcan, commander à souper dans un restaurant quand personne ne parle ta langue ou trouver ton bus dans un terminus à Bangkok est difficile, vous n’avez jamais cherché à acheter un chandail à votre mère.
Bienvenue à bord.
Les tailles. C’est quoi ça??!!
Heu. Des lettres. Parfois des chiffres.
Pas nécessairement dans l’ordre.
Ça, on s’habitue. On trouve des trucs.
Le fitting, c’est autre chose.
Une autre paire de manches.
Tu peux acheter un medium trop grand ou un large trop petit.
À Paris, alors que je fouillais dans une boutique à la recherche d’une taille plus grande, je m’adresse à une vendeuse, mais c’est une cliente qui me répond en hurlant : bienvenue en France, monsieur! Ici, on habille que les petites! Y’a rien pour les femmes de notre taille! Rien!
Oui. Oui. Je comprends. Notre taille.
À New York, deux petites dames curieuses qui me regardent fouiller les lainages, tombent en amour avec moi quand je leur dis que je choisis des gilets pour ma mère.
⁃ Izz shopping for his mom, sooooo sweeeeeet!
À Singapour, alors que j’ai dans les bras, une pile de chandails de grandeurs différentes, je demande à une vendeuse si je peux essayer…
⁃ Heu, ce sont des cabines pour dames…
⁃ Je sais, mais y a des cabines pour hommes?
⁃ Vous êtes dans une boutique pour dames, monsieur…
Oui. Je sais.
Oui j’essaie.
Ben oui.
Criss.
Comment veux-tu que je fasse pour savoir si ça fitte?
Je les essaie.
Je porte les gilets de ma mère sur moi.
J’entre dans la cabine. Je mets le chandail et je me fais des seins en tirant sur deux coins avec mes doigts. Je regarde si le chandail remonte pas trop sur la bedaine. J’imagine ma mère dedans.
Je remercie la présence des miroirs à l’intérieur des cabines.
J’ai les joues rouges à penser qu’il y’a des caméras dans les cabines.
Je me trouve drôle quand je sors de la cabine et dit : ça fait, merci, je vais le prendre en vert, svp.
Dans une boutique à Barcelone, j’ai demandé à une cliente ayant la même shape que ma mère, quelle grandeur, elle prendrait… et quelle couleur.
Gracias. Es para mi madre. Si. Si. No para mi. Ha ha.
En Colombie, au royaume du macho, je suis allé essayer des vêtements de femme dans les cabines d’essayage des gars. Une autre victime de la dope ont-ils dû penser.
En Indonésie, je l’ai mis sur moi, en pleine boutique, devant l’étalage et un couple amusé de me voir avec un chandail rose orné de jolies petits boutons blancs sur la manche.
Je l’ai acheté, môman.
Il te fera bien.
Comme à moi.
Billets que vous pourriez aimer
Bing. Bang.
 Commander au restaurant. Faire des grands signes au serveur pour qu’il revienne. Changer du tout au tout ce que j’avais commandé. De quoi rendre folle une cuisine. Ça m’arrive. Bing. Bang.
Commander au restaurant. Faire des grands signes au serveur pour qu’il revienne. Changer du tout au tout ce que j’avais commandé. De quoi rendre folle une cuisine. Ça m’arrive. Bing. Bang.
Le matin d’un pitch, il m’arrive fréquemment de changer le slogan principal de la campagne, refaire rapidement un autre montage et remonter les maquettes. À une demi-heure de présenter. Jeter à la poubelle des heures de création. Bing. Bang.
Au magasin, je regarde la chemise bleue, essaie la grise, achète la noire. Toujours la noire.
Non, merci je ne bois pas. Non, merci. OK, mais un seul. Oui, svp. On peut ravoir une bouteille?
J’achète un truc. Ramène le truc à la maison. Regarde le truc. Regrette le truc. Ramène le truc au magasin. Échange le truc. Rachète le truc. Ramène le truc à la maison. Regarde le truc. Regrette le truc.
Écouter 18 épisodes d’une série en 24 heures. Étirer la saison 3 sur 2 ans.
Spotify a de la misère à me suivre. T’écoutes n’importe quoi, man. Pas n’importe quoi d’Éric Lapointe. N’importe quoi de Marc Gauthier.
Devant trop de choix, je suis paralysé. Incapable de réfléchir.
J’ai 8 ans devant ma boîte de Prismacolor.
Les couleurs et les typographies me rendent dingue.
Je voudrais vivre en noir et blanc. Et en Helvetica.
Y a deux mois, on planifie un voyage pour cet été. Taiwan. Achat de billets d’avion. Achat de guide. Achat de romans de voyage. Planification sommaire. Où. Comment. Pourquoi. Et là, samedi, au lit, le iPad sur les cuisses : une illumination. On n’y va plus. À deux semaines de partir. Quoi? Nan. Ben là. On change. On va ailleurs. Bing. Bang. Annuler les billets. Payer des pénalités. Ranger les livres. Pour plus tard.
Pas toujours facile la vie avec moi.
Je peux vous en parler.
Je suis la personne avec qui j’ai vécu le plus longtemps.
Je suis incapable de prendre le chemin le plus droit. Le plus rapide. Le plus simple.
Je me perds tout le temps.
En voyage. Sur la route. Dans ma tête.
Moi aussi, j’aurais sûrement découvert Haïti en cherchant l’Inde.
Il m’arrive d’envier les gens qui ont tout tracé leur vie d’avance.
Et puis je m’imagine comme eux. Et l’envie passe. Bing. Bang.
Je ne juge personne en disant ça. Je dis seulement que je ne suis pas fait pour ça.
Il m’arrive de penser qu’il me manque le gène de la décision.
Tu es certain? Non.
J’aurais été incapable de jouer à Who Wants To Be A Millionnaire. Incapable.
Marc, is it your final answer?
Heu…
Final?
Je. Sais. Pas. Trop.
Noui?
Billets que vous pourriez aimer
Le gazon.
 J’ai tourné le coin de la rue Germain, cette rue anonyme, sans vie, que je ne connaissais pas avant d’y habiter. Les rues sont comme les gens : avant de les croiser, on ne s’y intéresse pas.
J’ai tourné le coin de la rue Germain, cette rue anonyme, sans vie, que je ne connaissais pas avant d’y habiter. Les rues sont comme les gens : avant de les croiser, on ne s’y intéresse pas.
Elles font partie du décor, ont des noms, des vies, avec des enfants, des couples, des conflits, des amours, des joies et des peines qui nous sont complètement inconnus. On peut passer une vie entière sans en traverser une et tout à coup, bang! on ne pourra plus l’ignorer. Elle fait dorénavant partie de notre vie. Ou du parcours de celle-ci. Les rues, comme les gens, nous mènent ailleurs ou nulle part.
C’est selon. Cul-de-sac. Grand voyage.
Bref, j’ai monté la côte jusqu’à chez moi et j’ai réalisé que le gazon du voisin était vert. Oui, vert. Un vert fluorescent. Un vert parfait. Un green de golf. Une pub de Weed Man™. Un décor de soap des années 70. Irréel. Je n’en ai pas fait de cas immédiatement, tout le monde sait que le gazon est toujours plus vert chez son voisin. Surtout quand tu ne possèdes même pas un mini lopin de terre à toi. Je me suis dit que ma relation avec la pelouse avait peut-être changé. Peut-être étais-je devenu romantique depuis que je n’avais plus de tondeuse. Rêveur. Illusionniste. Imparfait. Ailleurs. Mais je m’éloigne. Je voulais seulement vous parler de la couleur de ce gazon. N’ironisez pas. Je sais que c’est sa couleur naturelle quand c’est la saison, mais au moment précis quand je l’ai aperçu, en tournant le coin, ce vert m’a bouleversé.
Depuis quand était-il aussi vert?
Ce matin? Aucune idée.
Hier? Encore moins.
Il y a une semaine?
Un mois?
Depuis quand sommes-nous le printemps?
L’été?
Le sommes-nous vraiment?
Bon. Vous rigolez.
Vous me croyez fou.
Peut-être.
Ou pas.
J’ai l’impression que ce gazon est passé de neige blanche, neige noire, à gazon vert. Sans que je le sache. Sans que je le réalise.
Le temps va si vite?
Le temps va si vite.
Ce n’était pas une question.
Plutôt une constatation.
Je tourne ce coin de rue deux fois par jour.
Deux fois.
In.
Out.
Et je n’avais rien vu.
Rien.
Jusqu’à ce soir.
Du gazon.
Du foin.
De jaune à vert.
Soudainement.
Si je n’ai pas vu ça, je n’ose pas imaginer tout ce que j’ai manqué.
Il vous est arrivé de quoi?
Vous avez changé de boulot?
Vous êtes malade?
Vous avez perdu un être cher?
Vous vous êtes marié?
Séparé?
Je lis deux à trois quotidiens par jour.
J’ai l’impression de ne rien connaître.
Je croise plein de monde.
Sans rien savoir d’eux.
Moi-même.
Je n’ai pas l’impression que j’en sais plus sur moi.
Pas plus que ça.
J’ai pensé retourner voir le gazon.
Celui du voisin.
Pour voir s’il était aussi vert que ça.
Pour voir comment.
Pour comprendre.
Pourquoi.
C’était peut-être uniquement l’effet de la pluie.
Il pleut tellement en mai.
On est en juin?
Vraiment?
Vous êtes certain?
Le temps passe si vite.
Si vite.
Billets que vous pourriez aimer
Éloge de la paresse.
 Toute l’avant-midi, j’étais en réunion de planification stratégique avec un client. On discute.
Toute l’avant-midi, j’étais en réunion de planification stratégique avec un client. On discute.
Autour de la table des jeunes, des moins jeunes et des encore moins jeunes. Vous ne saurez pas où je me situe. No Way.
Qui parle stratégie, parle campagne. Qui parle campagne, parle marchés ciblés. Qui parle marchés ciblés, parle médias différents.
Les plus jeunes arguent qu’il ne faut pas être trop verbeux.
Une image vaut mille mots.
Tant mieux si elle bouge.
Faut surtout pas trop en dire.
Sinon le consommateur décroche.
L’ère des 140 caractères.
Faut surtout pas trop en dire.
Utiliser des mots faciles.
On est tellement bombardé.
Faut comprendre.
On nous sollicite 1000 fois par jour.
Non.
Ça me fait chier tout ça.
Ce côté nivellement par le bas.
Pas trop écrire. Pas trop être compliqué.
Comme on était en brainstorming et que tout était possible, j’ai dit : fuck, racontons de longues histoires. Mettons de la chair autour de l’os. Démarquons-nous par nos textes à n’en plus finir. Devenons les Proust de la publicité.
Il y a un délire pernicieux dans la tendance de vouloir raconter des histoires à tout prix, mais de le faire facile, avec le moins de mots possible. En vidéo. Surtout, évitez la lecture. Eurk. La lecture. LA LECTUUUUUUURE.
Je rêve souvent aux publicités oldstyle, ou le copywriter nous menait une histoire tissée de mots savoureux. Où le body copy de la pub avait 4 paragraphes. Où la pub nous persuadait à coup de mots, d’arguments, de poésies, de rêve.
Pas de stupides hashtags de marde. #Insipides. #Anonymes. #Faciles.
Des mots.
Simplement.
Alignés. Avec des verbes. Des subjonctifs. Des idées.
Traitez-moi de vieux monsieur. De nostalgique. Vous avez le droit. Mais votre délire de vouloir tout réduire pour faciliter nous rend lâches comme des ânes. Quand j’étais gamin, on se moquait de nos amis qui lisaient le doigt sur la ligne de texte. Aujourd’hui : tout le monde balaie du bout de l’index le contenu résumé de leur application Facebook.
On ne lit plus.
On regarde.
On balaie.
On lit 10 mots et on se fait une idée.
Bravo.
Vous êtes bons.
Moi, il y a des jours, après avoir terminé un roman de 500 pages, j’arrive à peine à saisir où l’auteur voulait en venir.
Peut-être qu’il me manque une pièce au cerveau. Que je suis lent.
Nan.
Je vous niaise.
Oubliez ça.
C’est uniquement que les gens sont devenus paresseux.
On veut du tout-cuit-dans-le-bec.
Svp. Résumez-moi.
Facilitez-moi la job.
Je suis occupé.
Tellement.
Telllllleeeeeemmment.
Boulechite.
On-nivelle-par-le-bas.
Les réseaux sociaux nous rabâchent l’éternel « faut être vrai ». On n’aura jamais été aussi faux. Aussi stagé. Regarde comment je suis heureux. Regarde. REGARDE. JE SUIS FULL HEUREUX!!!!!. #heureux. #full. OK. Tu comprends mieux là?
Avec nos posts planifiés sur un calendrier – N’oubliez pas d’écrire 3 fois par semaine / même si vous n’avons rien à dire. Faut suivre le calendrier de notre consultant.
Pas de farce.
Vous ne trouvez pas qu’on a atteint le fond?
Que ça serait plus logique qu’on ait plus de profondeur.
Au lieu de.