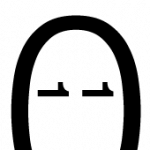Chroniques malaysiennes 01

Je suis un œuf cuit sur une plaque.
Il faudra décoller mes sandales avec une spatule.
Chow Kit. Kuala Lumpur. Malaisie. Red district.
Quartier typique de Malaisie. Je peux pas dire si c’est vrai, j’y suis que depuis hier.
Assis à une table de plastique, je prends une Tiger. Une bière locale. Mon voisin avec qui je partage la table n’a même pas levé les yeux quand on m’a assis à celle-ci avec lui. Il sale son eau tonic machinalement. Juste derrière nous, un enfant trisomique mange du vermicelle et ça le fait rigoler de me voir. J’ai bu ma bière d’un trait. Un gars sort du Saguenay, mais on sort jamais le Saguenay du gars. Autour de moi, Chinois et Malais et quelques Indiens. Rien qui me ressemble. J’écoute, mais comprends rien aux discussions des tables d’à coté. Je suis à l’autre bout du monde. Tant mieux. Ça fait souvent du bien de rien comprendre.
Il fait chaud. Très. Avec le facteur d’humidité, on frise le 50. J’ai voyagé dans pas mal de places, mais là je frappe un mur. Mes vêtements me collent à la peau. J’ai l’impression de nager debout. Je rêve de m’imperméabiliser les aisselles avec une couche de Varathan.
Kuala Lumpur n’est pas une ville où l’on peut respirer. Entourés de béton, on a l’impression d’être dans un tube de ciment. L’humidité est à son comble. Chaque pouce carré est habité. Quand je vois un arbre, j’ai le goût de le féliciter d’aspirer tout ce diesel pour nous. En quittant l’appartement ce matin, ça sentait aussi la fumée. Comme chez nous quand nous subissons des feux de forêts au nord. J’avais lu que cette boucane venait tout droit d’Indonésie. Pendant les brûlis annuels des agriculteurs indonésiens. J’en sais trop rien. Je sais seulement qu’il ne faut pas être asthmatique pour habiter ici.
KL, comme on dit ici, n’est pas tout à fait pour marcher non plus. Les artères piétonnières sont souvent petites ou inexistantes. Les scooters et les voitures sont les maîtres des lieux. Traverser un rue est une course à obstacles ou les feux de circulation sont des parures, tout autant que les bandes jaunes sur l’asphalte.
Avant de m’assoir à cette table avec mon inconnu saleur de tonic, je suis allé faire une virée au marché de Chow Kit. Si, en voyage, certaines visitent les musées, moi je visite toujours les marchés publics. Et là, disons que j’ai été servi à point. Un toit bancale de tôle, des étales de poissons vivants, des poulets accrochés, des morceaux de viandes débités avec ferveur. Les sandales dans le jus de cequiquouledepartout, des odeurs qui te réveilleraient un mort, mais surtout des marchands qui y travaillent. Cigarettes au bec, on assomme des poissons récalcitrants, on arrache des cœurs de poulet, ça rit fort, avec leurs bouches édentées. Pris quelques clichés avec permission.
– ouére are iou from?
– Canada. I’m french canadian…
– Haaaa, canada…
Les gens sont très gentils. On cherche toujours à nous orienter. Ouére dou iou want to go. Les filles me sourient. Life is cool.
Bizarrement, l’événement le plus traumatisant depuis que je suis parti, s’est déroulé à l’aéroport Charles-de-Gaulle. Un homme en colère à enguirlandé sa femme devant tout le monde. «Grosse conne!» qu’il lui criait à deux pouces des oreilles. Ça ma mis à l’envers pendant des heures. Depuis que je suis en Malaisie j’ai croisé beaucoup de femmes voilées. Certaines couvertes des pieds à la tête, avec uniquement ce petit grillage pour voir un peu, mais je n’ai jamais senti une agression aussi sévère que celle de ce Français qui engueulait sa femme.
Drôle les perceptions, hein?
Billets que vous pourriez aimer
À qui tu parles? À moi.
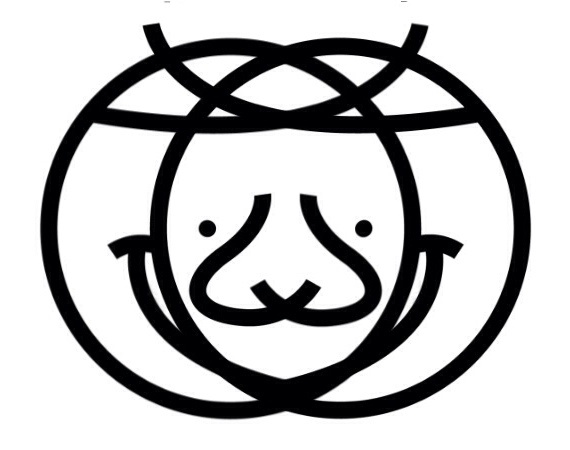 Le dimanche, ma mère vient souvent souper à la maison.
Le dimanche, ma mère vient souvent souper à la maison.
C’est le juste retour des choses.
Dans la vie, chacun son tour.
Le dimanche, même les weekends pluvieux, le soleil vient toujours nous dire bonjour.
Comme ma mère.
On soupe tôt. Contrairement à tous les jours de la semaine. Pour l’accommoder, bien sûr, mais aussi par ce que le dimanche, même si on le travaille, c’est la journée où chacun se remet à zéro. Pour recommencer lundi d’aplomb.
Bref.
Dimanche, maman est venue souper.
Discussion autour de la table.
Moi: En vieillissant, je réalise que je parle tout seul.
Maman: Moi aussi, je parle toute seule. Souvent.
Moi: Toi, tu es vielle, c’est normal. (RIRE). Sérieux, je me parle vraiment tout seul.
Maman: Va chier. (Ma mère m’envoie régulièrement chier. Faut que les gens le réalisent). Quand je passe des journées, seule dans la maison, ou que je me trompe en faisant des besognes, je me parle tout haut, en me réprimandant.
Moi: Moi, c’est pareil. Je travaille devant mon ordinateur et je suis là à me questionner sur un choix de typo, de slogan ou de couleur et… Je me réponds. Oui, non, Marc, tu devrais pas faire ça. Ou tu devrais. Mais pas dans ma tête, de vive voix. Et c’est aussi de vive voix que je me réponds.
Maman: Comme moi.
Moi: Ça me rassure pas, tu sais. Me comparer à une personne de ton âge…
Maman: Va chier. (Encore! Vous êtes témoin!)
Je me parle tout seul.
Devant mon écran.
Dans ma voiture.
En courant.
Là, à l’instant, en écrivant ce billet.
Je me parle tout seul.
Et aussi loin que je me souvienne, depuis bien longtemps. Depuis l’adolescence, je dirais. Dans ma chambre. Mon cocon. Je me questionne. Je me réponds. Je me choque contre moi. Je me bourrasse. Je me remets en question. Je me challenge. Je me traite de con comme je me félicite.
J’ai longtemps capoté sur le fait que la personne à qui je m’adressais était moi-même. Entendre sa propre voix et se répondre, c’est biz au début. Mais on s’habitue. On s’apprivoise.
Je me targue souvent d’être un solitaire.
Je travaille seul.
Je suis un solo. Un loner, comme disent les anglos.
Et je me plais dans ce rôle. Contrairement à ce que les gens pensent, les autres ne me manquent pas. Je suis bien seul. Je n’ai jamais ressenti le vide de me retrouver avec moi-même.
Peut-être parce que je suis en paix avec moi-même. Je me trouve pas toujours des plus rigolos, mais je m’aime bien.
Je suis bien avec Moi.
Mais le suis-je vraiment? Ou simplement trop pour réaliser quoi que ce soit.
Je pense que se retrouver seul est sain. Et surtout salutaire. Ça nous permet de remettre les vrais affaires en perspective. De visiter une personne qu’on a tendance à négliger dans le tourbillon du quotidien. Soi-même.
Moi: Asti que chu pas certain que c’est une bonne idée…
Encore Moi: Bahhh, ça sera pas la première fois que tu vas te tromper…
Tel Tom Hanks, dans Cast Away, j’ai l’impression que je suis mon meilleur allié. Celui qui me dira si tout va bien ou le contraire. Celui qui dit : hey chummy, quoi que tu fasses, je serai toujours là.
Je suis peut-être fou.
Peut-être.
Ou seulement vieux, direz-vous.
Allez chier.
Comme dirait ma mère.
Billets que vous pourriez aimer
5 raisons pour m’engager, mais tout autant pour ne pas le faire.
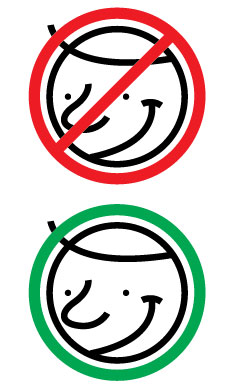 Simplifions-nous la vie.
Simplifions-nous la vie.
Voici cinq raisons qui vous convaincront de travailler avec moi ou de ne pas le faire.
1. Tempus Fugit
Ai-je le temps de réaliser votre mandat?
Il m’arrive de travailler la nuit.
Il m’arrive de travailler la fin de semaine.
Il m’arrive de me tourner les pouces toute la journée.
Il m’arrive de procrastiner des heures.
Il m’arrive d’avoir trop de temps.
Il m’arrive de ne pas avoir assez de temps.
La création n’est pas une job de production, mais de réflexion. On sait quand on commence, mais on sait rarement quand ça finit. Il m’arrive d’avoir des idées géniales en si peu de temps que parfois, j’oublie qu’il faut que je bûche des jours pour en trouver une nulle. Je sais que ça peut vous compliquer la vie, mais c’est comme ça. Comprenons-nous bien: la notion de temps en est une élastique. Il m’arrive de réaliser des mandats dans un temps record comme je peux dépasser une date de tombée parce que je trouve que vous méritez mieux que l’idée pondue pendant ce court laps de temps.
2. Bacon
Comme le temps c’est de l’argent, vous pouvez facilement vous imaginer que la notion d’honoraires se décline de la même manière.
Il m’arrive de me faire dire que je charge trop cher.
Il m’arrive rarement de me faire dire que je charge trop peu.
Il m’arrive de me tromper dans l’évaluation du travail à accomplir et manger mes bas.
Il m’arrive de tomber sur une idée géniale dans un temps record et réaliser que je fais une vraie bonne affaire avec votre mandat.
Soyons clairs : si c’est un prix que vous cherchez, vous n’êtes pas à la bonne place.
Pas que je ne suis pas abordable ni non négociable, mais si votre idée première en m’engageant est de sauver des sous ou de vous servir de moi afin de négocier votre fournisseur régulier, je ne pense pas que notre relation débute. Voyons les choses comme elles sont : mon travail consiste, entre autres, à vous faire connaître, à vous vendre, à vous définir pour ainsi vous améliorer et ultimement, vous faire faire de l’argent. Ça vaut et coûte quelque chose.
Je considère que mes créations sont pertinentes, imaginatives et valent le prix demandé. À vous de voir.
3. Fun
J’aime ce que je fais. Je tripe sur mon travail. Jamais routinier, le métier de création est directement fait pour moi. Malgré les heures, les angoisses (oui oui, la recherche d’une idée est souvent un supplice intellectuel…), il faut garder sa bonne humeur. Labeur égale bonheur, mais uniquement dans la bonne humeur.
J’ai besoin de me sentir appuyé.
J’ai besoin de sentir que la confiance s’installe.
Je déteste quand on me bouscule.
Je crois au respect mutuel.
Rire n’enlève rien au sérieux d’une démarche.
Garder son naturel éteint et tenter d’être quelqu’un d’autre est-ce qu’il y a de plus turn-off quand tu brainstormes.
Mes rencontres client ne sont pas traditionnelles. J’aime avoir du plaisir. Je ne me prends pas au sérieux, même si certains de mes mandats demandent de l’être. Démêlons les individus du mandat. On peut avoir des fous rires quand on travaille sur une campagne de sensibilisation sérieuse. Ça détend l’atmosphère et ça pousse les relations au-delà du simple contact client-fournisseur de services. Avoir du plaisir en travaillant, c’est sain.
4. Les p’tites vites
J’aime bâtir de longues relations avec mes clients. Les one shot deal ne m’intéressent pas. Je ne cherche pas à travailler sur tous les mandats pour lesquelles on me sollicite.
Si je vous connais en profondeur, j’anticipe vos besoins.
Si je vous connais en profondeur, je connais votre réalité.
Si vous connaissez ma réalité, vous comprenez que sous mes airs parfois désorganisés, je livre toujours la marchandise.
Si vous connaissez ma réalité, vous savez exploiter mes forces.
Quand on travaille sur une longue période avec un client, toute la notion d’investissement prend sa valeur. Chaque action n’a pas nécessairement une facture attachée à celle-ci. Comme dans une relation amoureuse, on peut toujours compter l’un sur l’autre pour avancer. J’ai des clients qui me suivent depuis plus de 15 ans avec qui j’ai des relations de symbiose qui dépassent largement mon expertise première. Certains me demandent un avis sur des transactions immobilières, d’autres sur des changements stratégiques qui dépassent les communications. On ne conte pas ce genre de secrets à une nouvelle flamme, mais à ton vieux pote, oui.
5. Parfait pour moi
Même si j’ai certaines facilités dans certains domaines, j’aime qu’on me propose des trucs auxquels j’ai rarement été mandaté. Avec l’expérience, j’ai appris à connaître mes limites et si je ne me sens pas à l’aise j’oriente le client vers quelqu’un qui saura mieux le réaliser.
Un mandat peut-être ennuyant, mais super payant.
Un mandat peut-être génial, mais avec un budget de misère.
Le mandat doit nécessairement m’intéresser.
J’aime faire des trucs différents.
Je n’aime pas qu’on me limite.
Je ne pense pas être unidimensionnel et ce n’est pas parce que je n’ai pas réalisé de mandats dans votre domaine que je ne suis pas en mesure de le faire. Moins connaître un champ d’expertise peut s’avérer un atout important puisque la connaissance vient souvent avec des paradigmes et des idées précises. Moins de balises, plus de créativité.
Billets que vous pourriez aimer
Récompense moins vraie qu’on pense.
 À son habitude, Applied Arts Magazine consacre son édition de septembre/octobre à ses Awards annuels qui récompensent ce qui se fait de mieux en graphisme et en publicité au Canada.
À son habitude, Applied Arts Magazine consacre son édition de septembre/octobre à ses Awards annuels qui récompensent ce qui se fait de mieux en graphisme et en publicité au Canada.
À son habitude, elle a choisi son jury parmi la crème de la création parmi toutes les agences au pays. La crème qui choisit la crème.
Jusqu’ici rien de bien anormal. Sauf que l’agence Zulu Alpha Kilo, responsable de la conception de l’édition a décidé de soumettre à un jury composé de «gens ordinaires», les mêmes pièces.
Résultat : 70% des créations primées par le jury du magazine provenant d’agences de pub n’ont pas trouvé preneur dans le coeur de l’autre jury. Celui-ci, composé de consommateurs, a clairement signifié que les publicités primées ne les rejoignaient pas, concluant ainsi que les agences vivaient dans leur bulle.
Hahaha! Bien fait! Je me marre.
Car voyez-vous, comme les consommateurs, j’ai toujours vécu un malaise vis-à-vis ces prix.
Résultats? Quels résultats?
Ce qui m’a toujours déplu dans ce genre de concours est le manque de données relatives quant aux résultats des campagnes. Si les objectifs ont été atteints, si le mandat a bien été réalisé. On juge l’esthétisme, l’idée, sans toutefois vérifier de sa pertinence. Qu’en déplaisent à certains créatifs, nous avons avant tout un mandat de commercialisation, de persuasion ou de communication à réaliser. Oui, on peut (doit) être créatif, imaginatif, cela va de soi, mais tout autant d’être précis et approprié. Il est primordial, selon moi de juger la création par rapport à son succès commercial ou communicationnel. Sinon, on juge quoi?
Mon exemple
J’ai gagné à deux reprises des Awards d’Applied Arts (les cadres s’empoussièrent dans mon bureau). Les deux fois pour des emballages. Mon premier, un produit destiné à un jeune public, a été un fiasco commercial : le produit ne répondait nullement à la clientèle. Mon design fût jugé comme étant créatif, mais le consommateur a boudé le produit sur les tablettes. Bien que mon mandat fût réussi à moitié (je n’étais tout de même pas responsable du goût !), le produit, lui, n’a jamais pris son envol. Dans le cas de mon deuxième prix, la compagnie a connu des ratés et dû rapidement se mettre à l’abri des créanciers. Encore ici, on jugera ma création géniale, mais le produit restera plus longtemps sur mon mur que dans les magasins.
Oui, je pense que je méritais ces prix par rapport à la valeur artistique de mes créations, mais si on m’avait jugé sur le résultat final, je ne suis pas certain qu’on m’aurait attribué un prix. Car nous sommes avant tout au service d’un produit, et non l’inverse…
Il y va de même pour toutes les créations primées dans ce genre de magazine. On en juge la beauté, l’esthétisme, l’intelligence, mais aucunement son efficacité réelle à séduire et convaincre. Sans non plus, y comparer le budget disponible, ni de la véracité de la pièce (on sait que certaines agences envoient de faux travaux jamais publiés).
Bien sûr que comme professionnel, nous avons tout de même nos limites par rapport aux produits de nos clients. Je peux bien l’emballer, en parler et vous persuader que c’est un bon produit, mais si celui-ci est de la chnoute, y aura pas grand design ou pub pour le sauver. Nous avons nos limites. Comme ces prix qu’on nous décerne.
Party privé.
Le deuxième aspect qui me dérange dans cette distribution de prix, c’est tout le côté gamique du truc.
Regardez la liste du jury et vous connaîtrez le nom des gagnants. Ils y sont tous. Jury et gagnant. Juge et partie.
Je me rappelle, il y a une dizaine d’années avoir envoyé un courriel-Molotov au rédacteur en chef du défunt magazine Grafika pour me plaindre de sa sélection annuelle. Une seule agence hors de Montréal avait encore été primée (une firme de Québec !) et c’était tout. 514 seulement. Comme si passé Montréal, rien ne se créait. Un néant publicitaire. On parlait tout de même de prix récompensant le graphisme québécois. Pas uniquement montréalais. C’était pourtant cette même année où l’on venait de me récompenser chez Applied Arts – on était alors 3 ou 4 agences du Québec à avoir remporté un Award. Excellent au Canada, mais pas assez pour Montréal.
J’ai depuis cessé de participer à ce genre de concours.
Je n’y vois plus aucun intérêt.
On dira que j’ai perdu le goût de me mesurer aux autres.
Je répondrai que je préfère que mes clients se mesurent entre eux.
Et aux consommateurs de choisir.
> Emballage de pommes de terres récompensée par Applied Arts.
Billets que vous pourriez aimer
Pourquoi ne pas me laisser le faire?
 Dernièrement un client m’a mandaté pour lui créer une publicité dans un magazine spécialisé. Rien de compliqué. Une pub pour le vendre dans une publication directement reliée à sa clientèle cible. Quand je vous dis rien de compliqué, c’est plus que vrai. Le client avait ajouté à sa demande une description tellement claire de ce qu’il voulait qu’il m’était impossible de m’égarer. À son courriel était joint le texte de la pub dans un document Word™, une photo en format .jpg, une carte géographique et une recette précise où positionner chacune des pièces du casse-tête.
Dernièrement un client m’a mandaté pour lui créer une publicité dans un magazine spécialisé. Rien de compliqué. Une pub pour le vendre dans une publication directement reliée à sa clientèle cible. Quand je vous dis rien de compliqué, c’est plus que vrai. Le client avait ajouté à sa demande une description tellement claire de ce qu’il voulait qu’il m’était impossible de m’égarer. À son courriel était joint le texte de la pub dans un document Word™, une photo en format .jpg, une carte géographique et une recette précise où positionner chacune des pièces du casse-tête.
Rien n’était laissé au hasard. Rien.
Pour l’exercice, j’ai décidé de faire exactement ce qu’il me demandait.
J’ai placé chaque truc à la place désirée sans me demander si c’était ce qu’il fallait faire.
J’ai exécuté à la perfection la commande. J’ai sauvegardé le document, cliqué sur envoyer et fait parvenir par courriel, l’épreuve au client, pour approbation.
Sa réponse fut plus que brève : « Ouais, je ne suis pas un graphiste, hein? lolll»
Voilà. Encore moins un communicateur.
J’allais le dire.
Mais y a souvent rien de mieux qu’un exemple pour convaincre.
Au lieu de me mandater à combler un besoin de communication ou de promotion, le client s’est aventuré à faire ma job. MA job.
Parce que s’il m’avait choisi parmi d’autres professionnels, c’était pour ma créativité, certes, mais avant tout à ma capacité de répondre à un besoin. Le client n’avait aucune malice. On a bien ri, tous les deux, de cette expérience. Mais pour être certain qu’il comprenne bien l’essence de mon intervention, je lui ai fait quelques recommandations, que je vous résume ici.
Vous êtes les meilleurs dans ce que vous faites, moi aussi.
Vous êtes les tops dans votre domaine, mais quand vous tombez dans le mien, ça craint. Vous n’êtes pas à la hauteur. Je ne prendrais pas le risque de vous dicter quoi que ce soit dans votre fonctionnement interne, car je ne pense pas avoir votre capacité de dirigeant ou d’entrepreneur. Prenez exemple.
Vous avez des goûts personnels, je suis au courant des dernières tendances.
Je passe mes journées et soirées sur le web. J’ai le nez dans les revues de marketing, je m’intéresse à l’Art en général, je suis au parfum des tendances du marché. Je peux vous dire ce qui carbure en ce moment, quelle couleur sera à la mode l’automne prochain, quelle typo est in, laquelle est dépassée. Vous avez des goûts personnels, moi aussi. Sauf que les miens, je les laisse de côté quand je travaille pour vous. Ce que vous ne faites pas, mais devriez.
Vous avez le nez dans votre caca. Pas moi.
Pas dans le vôtre en tout cas. Une des difficultés majeures que peut vivre une entreprise c’est la celle d’exercer un peu de recul par rapport à sa propre réalité. Trop dedans. Trop souvent les pieds dans le quotidien pour regarder derrière son épaule. Le syndrome du cordonnier mal chaussé. C’est normal. Je vis la même chose avec mon propre bouiboui. Mais avec le vôtre, je suis capable. Parce que c’est mon travail de le faire pour vous.
Vous ne pouvez pas tout dire.
Le texte que mon client m’a fourni était non seulement plate, mais comblait une page complète d’un document Word™. Plus de mots que d’idées. Ennuyant et redondant à moins d’être un historien et de vouloir répertorier les étapes importantes du développement industriel du dernier siècle. Je m’imagine très bien sa clientèle s’endormir au premier paragraphe et décider que le Larousse serait plus instructif et moins barbant à lire. J’utiliserai moins de mots que vous, mais ils seront choisis pour leurs capacités à bien cerner votre idée et bien convaincre vos clients. Mon slogan aura plus d’impact avec ses huit simples mots que la page de trois cents mots que vous me fournirez.
Vous ne pourrez tout régler.
Je sais que la pub coûte cher. Que moi aussi, je coûte cher. Raison de plus pour s’assurer que vous ne gaspillerez votre argent en la dilapidant dans un truc sans queue ni tête. Donnons-moi le mandat de simplifier vos communications, de passer un seul message, mais que celui-ci soit précis, compris et aie un l’impact souhaité. Concentrons-nous sur l’essentiel. Une chose à la fois.
Vous gaspillez votre argent et moi, mon temps.
Honnêtement, si mon client avait voulu sauver de l’argent, il n’aurait pas eu à me mandater pour cette pub. N’importe qui avec une certaine connaissance des logiciels de graphisme sur le marché aurait été en mesure de réaliser exactement ce à quoi il s’attendait. À une fraction du prix. Je ne dis pas ça pour être chiant, mais tant qu’à m’employer autant abuser au maximum de mon talent et de ma créativité.
Quand je rencontre un nouveau client, à la question pourquoi m’avoir choisi au lieu d’un autre, on répond souvent : j’aime beaucoup votre travail.
Pourquoi alors ne pas me laisser le faire?
Billets que vous pourriez aimer
Éphémère.
 Je fais dans l’immédiat.
Je fais dans l’immédiat.
Mon métier est de répondre aujourd’hui à des besoins d’hier. Je crée des publicités, des dépliants ou des affiches commandés pour solliciter, informer ou instruire, mais pas pour survivre à leur mandat premier.
La plupart des ces créations disparaitront avec le temps. Elles deviendront rapidement désuètes selon l’urgence de la demande.
Contrairement aux oeuvres d’artistes, ces pièces ne survivront pas aux modes, aux tendances ou seront incompatibles aux nouveaux médias. Y aura même de ces médias qui disparaitront apportant avec eux dans leurs sillons, toutes ces publicités adaptées uniquement pour eux. Qui se rappelle d’UBI, cette créature de Vidéotron. Plusieurs de mes créations dorment ainsi dans la mémoire morte de ces vieilles technologies. Tout comme ces sites web créés au tout début et issus d’une vieille programmation qui sont enfouis dans des disques de sauvegarde, des disquettes ou des cédéroms, qui eux-même s’empoussièrent dans des caisses empilées dans des placards obscurs.
Je fais dans le présent.
Mes slogans sont collés sur ce que vivent les gens, aujourd’hui. Pas demain. Avec les mots d’aujourd’hui. Avec les maux d’aujourd’hui. Des textes composés à partir d’une réalité directe. Ce que j’écris à l’instant présent a de grandes chances d’être inapproprié demain. Pas que nous changions nous-mêmes si rapidement, mais ce qui nous entoure, oui. Les arguments que j’utilise pour vous persuader d’acheter un produit ou de souscrire à un service seront caducs le temps de les écrire. J’exagère? Je vous ai vendu des disques durs de grandes capacités de 100 megs, des cassettes VHS haute définition et des modems ultrarapides de 56k. Je vous ai menti par procuration. Un innocent message qui, avec le temps, se révèle être un pieux mensonge.
Je fais des pubs qui seront vues, lus qu’une fois et puis bye bye. Terminé. Fini. Pour des mandats qui ne reviendront pas. Tu as un machin à vendre, tu fais de la pub, tu le vends, et tu n’as plus besoin de pub. Simple.
Vous n’avez pas vu cette annonce? Dommage. Elle était bien. Vous avez manqué un événement qui ne se reproduira plus jamais. Pouf. Disparu. Fallait être là.
Je fais dans l’instant. Pas après. Juste là. Là. Après, c’est trop tard.
Quand un client me demande de lui créer un concept qui passera le temps, je veux bien. Ce n’est pas par mauvaise volonté, mais je suis incapable d’anticiper le futur. Ce que les gens aimeront et auront besoin dans un horizon de cinq ans. Pas capable.
Quand j’étais à l’université, à la fin des années 80, je passais mes après-midi dans les centres de photocopies à agrandir des logos ou faire des collages pour mes travaux en design graphique. Quand j’avais fini mes devoirs, j’allais tenter de rejoindre des amis, dans un bar quelconque, sans savoir s’ils y seraient. Et quand je tombais sur eux, je prenais de leurs nouvelles directement. Aujourd’hui, mes travaux seraient conçus sur un ordinateur, je texterais mes amis pour leur donner un rendez-vous et devant eux, je passerais mon temps à continuer de texter aux autres. Vous croyez vraiment qu’un concept créé y à peine cinq ou dix ans tiendrait la route pour rejoindre deux clientèles tellement différentes? No way.
Quand j’aperçois encore de vieilles créations réalisées depuis plusieurs années, encore en circulation, je ressens souvent un malaise. J’y vois le travail du temps. La fatigue. Le manque de punch. J’aurais le goût de les retaper, histoire de les rafraîchir. De les dépoussiérer. Je me demande pourquoi le client a laissé glisser en abandonnant celle-ci au lieu de l’avoir amélioré quand c’était encore le temps.
Je me demande pourquoi il n’a pas pensé me rappeler pour le faire.
Peut-être suis-je tout aussi éphémère que mes créations.
Billets que vous pourriez aimer
Le rêve est une seconde vie.
 Cindy est décédée mercredi. Le lendemain de Noël. Elle avait 26 ans.
Cindy est décédée mercredi. Le lendemain de Noël. Elle avait 26 ans.
Elle était atteinte de la fibrose kystique. Maladie génétique qui touche les voies respiratoires et digestives entraînant un épaississement du mucus sécrété dans les bronches, les sinus, l’intestin, le pancréas, le foie et le système reproducteur.
J’ai rencontré Cindy, il y une dizaine d’années, lorsque j’ai réalisé le film «Le rêve est une seconde vie». Un documentaire commandé par CORAMH (un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le domaine des maladies héréditaires au Saguenay-Lac-St-Jean), ce film avait pour but de démontrer le quotidien des personnes atteintes de telles maladies. Des malades ou des parents d’enfants atteints s’étaient livrés sans pudeur à notre petite équipe, répondant généreusement à toutes nos questions, même celles pas toujours faciles portant sur leurs intimités.
– Ton rêve, ça serait quoi, Cindy?
Celui d’avoir des enfants.
Elle avait répondu de sa petite voix enrouée, comme si elle était à bout de souffle, cet état si caractéristique des personnes atteintes de la fibrose kystique. Assise dans son lit d’hôpital, en plein gavage, elle nous avait raconté les aléas de sa maladie. Le nombre incalculable de médicaments à prendre, ses visites impromptues et régulières à l’hôpital comme le jour de notre rencontre, le claping qu’elle devait s’imposer pour libérer ses poumons embarrassés. Elle nous avait aussi parlé de son chum qui la supportait tellement, qui lui remontait le moral dans ses moments de découragements.
Elle était toute menue, si frêle, dans ce grand lit immaculé. Fragile, certes, mais en même temps, si résiliente pour son jeune âge. Je me souviens de l’avoir entendu dire qu’elle se trouvait plaintive (!), qu’elle n’avait souvent pas la force de se battre. Je n’en revenais pas. Son quotidien était rempli de règles à suivre, de barrières, de médicaments à prendre, de deuils à réaliser. Et elle, du haut son minuscule corps malade, elle avait cette certitude qu’elle pouvait être plus forte.
Ce sentiment, toutes les personnes croisées pendant le tournage me l’ont partagé. Alors que je m’attendais à interviewer des gens abattus, sans espoir, j’ai plutôt rencontré des gens d’une force incroyable, luttant contre leurs corps, leurs peurs et une société pas toujours adaptée pour eux.
Quand Anne, la directrice de CORAMH à l’époque, m’avait approché pour la réalisation de ce documentaire, j’avais menti sur mon expérience dans un tel mandat. Mises à part ces quelques réalisations de publicités, je n’avais jamais produit un tel document. Mais je voulais le faire. Égoïstement, je savais que ce film changerait ma perception par rapport à la maladie et surtout me ferait rencontrer des gens incroyables. Je ne m’étais pas trompé.
Vingt heures d’entrevues pour une demi-heure de film. Écoutées des vingtaines de fois afin de ne rien manquer et de rendre du mieux que je pouvais ces rencontres inoubliables. Ces heures à réécouter des confidences, à revoir ces larmes apparaître au bord des yeux, de voir ses poings se refermer sur des colères non assouvies. Des heures à comprendre que l’humain est fort quand on l’attaque, qu’il est capable de vivre l’invivable. Cette volonté de se battre, de ne pas laisser le destin avoir le dessus.
Aujourd’hui c’est aux proches de Cindy de se battre. Leur combat commence. Celui de tenter d’oublier, de se ressasser les bons moments, de reprendre le cours de leur vie en conservant les meilleurs souvenirs pour les moments les plus difficiles. Survivre à la perte d’un être cher, c’est se retrouver en face de soi-même.
Cindy n’aura pas réussi à réaliser son rêve.
Le rêve est une seconde vie avait dit Gérard de Nerval.
Souhaitons à Cindy que cette seconde vie soit encore plus belle que dans ses rêves.
> Pour faire un don à Fibrose Kystique Canada
Billets que vous pourriez aimer
Entrepreneurs de bonne heure.
 « Jeune, je dessinais partout et inventais des histoires pour faire rire mes amis. Aujourd’hui, mes logos sont affichés partout dans le monde et mes slogans font vendre… » — Marc Gauthier, designer graphique — Traitdemarc™.
« Jeune, je dessinais partout et inventais des histoires pour faire rire mes amis. Aujourd’hui, mes logos sont affichés partout dans le monde et mes slogans font vendre… » — Marc Gauthier, designer graphique — Traitdemarc™.
En me servant de ma propre expérience, c’est le concept que j’ai présenté au comité des communications de l’Équipe étoile entrepreneuriale du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Un beau projet qui met de l’avant sept super personnalités-entrepreneurs qui rencontreront des centaines de jeunes de la région afin de les sensibiliser en les initiant au domaine des affaires en se basant sur leurs propres expériences.
Selon moi, un entrepreneur est avant tout une personne comme tout le monde, sauf qu’à la différence des autres, celui-ci a décidé de suivre son étoile. Tout jeune, il a su persévérer, recommencer, avancer en mettant son talent et sa détermination à profit. On dit souvent que le labeur porte fruit, mais il peut être avant tout synonyme de bonheur. Et ce, depuis toujours. Plus il commence jeune à s’y intéresser, plus les chances de réussir sont bonnes. Un entrepreneur de bonne heure est un entreteneur de bonheur.
Avec ce concept, mon but premier était de démontrer aux jeunes qui rêvent d’entreprendre que tout peut mener aux « affaires ». Que l’administration et la comptabilité peuvent être des domaines qui te laissent indifférent comme tu peux être rêveur, brouillon, sportif ou artiste et quand même avoir le gène entrepreneurial en toi. Il n’y a surtout pas un chemin unique, une seule voie qui mène au succès. Une seule branche à l’école pour y parvenir. Chacun peut y accéder s’il y croit vraiment. Qu’il est possible que ce soit ton acharnement à apprendre le piano ou les heures à pratiquer des figures sur la glace qui font de toi une personne qui fera son bout de chemin dans la vie. Que tes qualités qui tu réussiras à développer tout jeune, te suivront et ne pourront que s’améliorer avec le temps.
À partir de documents d’archives personnels (photos, vidéos), les membres de l’Équipe Étoile nous dévoilent donc comment ils étaient tout jeune, comment ils ont su évoluer dans le temps en mettant de l’avant leurs talents, leurs forces et leurs persévérances. La notion entrepreneuriale peut être difficile à assimiler pour un plus jeune. Mais il peut reconnaître, parmi les Étoiles, ceux avec qui ils partagent des passions, et ce même si celles-ci ont été vécues à des époques différentes. Ce qui rend l’expérience encore plus ludique. Un jeune sportif se reconnaîtra quand il réalisera qu’un entrepreneur qui a réussi, pratiquait le même sport que lui très jeune. Un autre, plus axé sur le domaine des arts saura faire le pont entre ses passions et celles d’un mentor plus âgé surtout s’il partage les mêmes. Au contraire de présenter les entrepreneurs comme des gens « hors de l’ordinaire », des superhéros inaccessibles, j’ai préféré les présenter tels qu’ils étaient en tant qu’un ti-cul d’une douzaine d’années, bien avant de devenir ce qu’ils sont aujourd’hui. Comme dans la notion du plus petit dénominateur commun, se comparer aux mêmes âges est plus juste que le faire avec trop d’écart.
Les sept membres de l’Équipe ont dû fouiller dans leurs vieilles photos afin de dénicher celles qui les représentaient le mieux à différentes étapes de leur vie. Comme j’avais fait la démarche personnellement avant eux, je me suis rendu compte que bien que nous changeons physiquement, nous demeurons ce que nous étions tout petits. C’est fascinant de voir qu’on a pas beaucoup changé de personnalité, que nos petits jeux de l’époque nous menaient lentement à ce que nous sommes devenus, aujourd’hui. Comme si toutes ces années nous auraient préparés à éclore, en accumulant chaque jour un peu plus de maturité.
Comme disait l’auteur Alexandre Jardin, dans son livre magnifique Le Petit Sauvage : « On ne se doit qu’à l’enfant qu’on a été ».
> L’Équipe étoile entrepreneuriale du Saguenay—Lac-Saint-Jean sur le web et sur Facebook
Billets que vous pourriez aimer
Souvent, vous m’énervez.
 Oui, oui, vous.
Oui, oui, vous.
Vous, qui écrivez sur Facebook plus vite que votre ombre.
Vous qui avez le statut revendicateur toujours prêt à faire feu.
Vous m’énervez à la longue.
Moi, qui suis extrêmement compréhensif. Moi, qui déteste la chicane. Vous réussissez tout de même à faire tourner mon humeur. À m’énerver. À me faire chier.
Y a des jours ou je me fous complètement de vos prises de position. Je vous laisse jouer à la victime. Mais y a d’autres moments où il faut vous remettre à votre place. Parce que ce n’est pas parce que vous avez une voix qu’il faut absolument l’écouter. Et ce n’est surtout pas parce que vous avez une opinion qu’il faut la partager. Surtout quand vous dites des niaiseries.
Prenez cette mini-tempête sur les réseaux sociaux à propos de cette façade d’un immeuble qu’on veut rénover en sacrifiant l’oeuvre d’art qui l’orne. Immeuble qui a déjà appartenu à mon client, Gagnon Frères. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, faites vos propres recherches, car le sujet de ce billet n’a rien à voir à propos de cette histoire. Mon problème, avec votre réaction, est uniquement au niveau de sa démesure et de son manque total de discernement quant à son ampleur.
Sur Facebook, sur la page de Gagnon Frères, certains annonçaient haut et fort qu’ils n’iraient plus jamais y magasiner leurs meubles. On menaçait le boycottage de la chaîne de magasins. On criait au malheur. On criait à la manigance. Au méchant loup.
Et bien, laissez-moi vous parler du Gagnon Frères que moi je connais.
Pendant que vous déblatérez votre venin sur les réseaux sociaux, des entreprises comme Gagnon Frères s’activent comme citoyen corporatif. Oui, je sais, vous détestez entendre ce discours. Les entreprises sont, pour vous, de méchants vampires qui sucent le sang des consommateurs. Uniquement. Mais comme je suis, moi aussi, un méchant publicitaire qui vous force à acheter des trucs chez ces méchants commerces, alors vous comprendrez que vous ne me trouverez pas dans vos troupes.
Des exemples? Gagnon Frères a été (ou est encore) un membre actif de la Fondation de Ma Vie qui amasse des fonds pour le développement de l’Hôpital de Chicoutimi; il participe aussi comme commanditaire à des événements culturels comme le Festival des Rythmes du Monde, le Festival de jazz de Saguenay, celui de Chicoutimi en Bouffe, au niveau sportif, il appuie Le Grand Défi Pierre Lavoie, Les Saguenéens de Chicoutimi, et plus de 1001 activités-bénéfices qui se passent partout dans notre région. Et j’en oublie, car je ne sais pas tout. Comme vous (sauf que moi, je préfère ne pas dire n’importe quoi). Parce que voyez-vous Gagnon Frères corporatif et son président Frédéric Gagnon, ne diffusent pas tout ce qu’ils font comme interventions sociétales, culturelles ou sportives. Parce que comme citoyen responsable, Gagnon Frères fait sa part, et ce, sans que personne ne le force à le faire. Parce que cela fait partie des valeurs intrinsèques de l’entreprise. Son ADN.
Mais ça, vous l’oubliez.
Mais ça vous ne voulez surtout pas l’entendre.
Vous préférez monter au front que de faire la part des choses.
Quand Rio Tinto construisait la Maison du Festival de jazz à Montréal. Y a eu un tollé de protestations de gens qui étaient outrés parce qu’elle allait porter le nom de ceux qui la finançaient complètement. Bordel. C’est bien du moins. Plus près d’ici, quand Desjardins et la Caisse de Chicoutimi s’affichent à la Zone portuaire parce qu’ils remettent une somme importante à la Corporation qui gère le site, il me semble aussi que c’est tout à fait normal. Quand une entreprise décide de prendre une part de ses profits et de l’investir dans son milieu que ce soit au niveau de la culture ou du sport, vous devriez plutôt les en remercier. Car ils ne sont pas obligés de le faire. Il y en a d’ailleurs plein d’autres qui ne le font pas.
Je ne dis pas que ces entreprises sont sans défauts. Qu’elles n’y trouvent pas leur compte (en crédit d’impôts ou visibilité). Qu’il faut nécessairement leur donner absolution sur tout. Je dis seulement que vos réactions par rapport à des sous-entendus sont tout simplement démesurées. Vous exagérez. Vous colportez de la merde sans vous en rendre compte. Vous jugez un événement sans le mettre en contexte. Sans en mesurer le pour et le contre.
Je travaille beaucoup avec des entreprises présentes dans leur milieu. Entreprises qui bien souvent, pallient un manque flagrant de ressources financières. Beaucoup d’organismes communautaires et culturels dépendent en totalité de ces dons. Sans l’aide de ces entreprises, via un système de commandite, il y a des événements culturels qui ne verraient jamais le jour.
Et si je vous demandais : vous, comme citoyen, que faites-vous? Hein?
Derrière vos misérables petits commentaires dénonciateurs sur Facebook, qu’est-ce que vous apportez réellement à notre société? Vous vous impliquez? Vous faites du bénévolat? Vous donnez des sous? Vous aidez votre communauté? Vous faites quoi?
Regardez-vous dans la glace avant de dire n’importe quelles âneries. Avant de bannir une entreprise, de vociférer des menaces de boycottage à son endroit, vérifiez vos sources et faites la part des choses quant à son implication complète à notre société. Et surtout, comparez-vous avec elle. Vous faites quoi pour l’améliorer notre monde à part avoir le cul devant votre ordinateur à dénoncer des pacotilles? Rien. Vous ne faites rien.
Vous ne faites rien, mais bordel que vous réussissez quand même à m’énerver.
—-
Je tiens à préciser que ce billet est une opinion personnelle que j’assume totalement, et qu’elle ne fait surtout pas partie d’aucun mandat professionnel.
Billets que vous pourriez aimer
Réincarnation de marc™
 Lors du dépôt d’un appel d’offres, on me demande souvent d’exprimer ma vision d’entreprise sur les droits d’auteur par rapport à mes créations. En termes plus simples, à la suite de la conception d’une marque, qu’elle sera la marge de manoeuvre du client quant à la propriété intellectuelle de celle-ci. En terme encore plus cru : hey coudonc, cé tu à nu’ aut’ ou pas, c’te logo-là ou c’te concept-là?
Lors du dépôt d’un appel d’offres, on me demande souvent d’exprimer ma vision d’entreprise sur les droits d’auteur par rapport à mes créations. En termes plus simples, à la suite de la conception d’une marque, qu’elle sera la marge de manoeuvre du client quant à la propriété intellectuelle de celle-ci. En terme encore plus cru : hey coudonc, cé tu à nu’ aut’ ou pas, c’te logo-là ou c’te concept-là?
Oui. Absolument. Tout à vous.
Dans ma philosophie, toute création réalisée dans un mandat précis, c’est-à-dire à partir d’une commande d’un client, appartiendra au dit client aussitôt les honoraires payés. Ainsi soit-il. Payez et recevez. Aussi simple que ça.
Vous pourrez en faire ce que vous voudrez. Appliquer ce concept sur le média que vous voulez. Vous en serez propriétaire, et donc en mesure de vous en servir comme bon vous semblera.
Bien sûr que j’aimerais garder un oeil sur la façon dont vous ferez évoluer cette création, afin d’en assurer la pérennité et l’évolution correcte, mais je comprends qu’il est parfois impossible de le faire. J’en conviens que certaines idées vivront mal la transition, comme d’autres subiront une belle évolution.
Comme je ne m’attache pas ou peu à mes concepts plus qu’il ne le faut, disons que leur deuxième vie, quand ils quittent ma tête, m’importe peu.
Il vous faut un exemple? En voici donc un beau..
En 2005, je créais pour le compte des Fermes Laurier Bouchard, une identification qui allait orner tous les emballages de boeuf que ces producteurs de la région mettraient en marché. Étiquettes, PLV (pièces en lieu de vente), camion de livraison, etc., allaient être aux couleurs de ce petit cultivateur sympathique qui avait troqué sa fourche pour une fourchette. Deux ans plus tard, l’entreprise connaissait quelques difficultés et dû se départir de sa division de coupes de viandes. Rachetée rapidement par un autre groupe, la marque continua de vivre et le boeuf d’être livré dans les supermarchés et les restaurants. Le consommateur n’y voyant que du feu puisque le même boeuf se trouvait dans le même emballage aux mêmes points de vente. Même bon goût, même qualité. La nouvelle entreprise de distribution avait continué à me consulter pour créer quelques nouvelles étiquettes. Et la marque repris du service, sans que l’on ne se rendre compte de rien. Jusqu’à ce qu’un nouvel épisode difficile concernant des problèmes d’approvisionnement revienne hanter la nouvelle entité. Cet incident marqua la fin de la marque de commerce «Boeuf Laurier Bouchard». L’entreprise de distribution cessa ses activités et vendit ses actifs au plus offrant. Business as usual. Les marques naissent, comme elles meurent. Et quelquefois elles se réincarnent…
L’an passé, un camion de livraison passant sur la rue attira mon regard. Sur le flanc du camion, en grosses lettres étaient inscrites « boeuf de qualité 100 % régionale » et tout au-dessous, une petite bonne femme, une bouchère avec une fourchette géante à la main. J’avais devant les yeux la preuve que la résurrection existe : mon logo revivait. Oui, notre cultivateur avait changé de sexe et de métier, sa ferme offrait maintenant une plus grande variété de produits, mais l’essentiel de l’identification était là. La nouvelle entité avait avalé la marque et décidé de l’adapter à ses besoins sans sentir le besoin de m’appeler. Peut-être elle ne savait même pas que j’étais à l’origine de la création de la première mouture. Voilà. Tant que les gens qui ont adapté la marque originale ne s’attribuent pas l’idée d’origine, je souhaite longue vie à Qualité Bouchard!